



En 2021





|
Débuts moroses en attendant le vaccin

En 2021 

|
Le 6 janvier, insurrection à Washington |
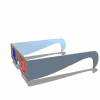
|
Chauffés à blanc par leur héro, les sympathisants de D. Trump ont tenté, et provisoirement réussi, d'interrompre le processus de désignation du président élu, Joe Biden
« Ce qui se passe depuis quatre ans aux Etats-Unis est grave, on le savait ; ce qui s’y passe depuis deux mois est gravissime »
Sylvie Kauffmann, éditorialiste au « Monde »
Publié le 06 janvier 2021 à 02h33 - Mis à jour le 06 janvier 2021 à 16h21
Sédition. Insurrection. Coup d’Etat. Loi martiale. Non, ce ne sont pas les éditorialistes d’El Nacional, de Caracas, qui nous font part de leurs inquiétudes sur la situation du moment au Venezuela, mais les chroniqueurs de politique intérieure du Washington Post, du New York Times et du Wall Street Journal. Et c’est bien de la démocratie américaine qu’il est question.
Ce qui se passe depuis quatre ans aux Etats-Unis est grave – on le savait. Ce qui s’y passe depuis deux mois est gravissime. La victoire incontestable de Joe Biden sur Donald Trump à l’élection présidentielle du 3 novembre 2020, avec une différence de 7 millions de suffrages populaires et 306 voix contre 232 au collège électoral, paraissait à même de permettre une alternance démocratique dans des conditions plus normales que celles qu’avait vécues l’électorat américain en 2000, lorsque l’écart de quelques centaines de voix en Floride entre Al Gore et George W. Bush avait retardé le résultat définitif de cinq semaines. Cette fois, les choses étaient claires. La parenthèse Trump pouvait se refermer.
Sauf que la victoire incontestable est contestée, et au plus haut niveau. D’abord devant les tribunaux. Agaçant pour le vainqueur, sans doute, mais la contestation restait dans le cadre des procédures prévues par la loi. Ces recours n’ayant pas abouti, faute de fraudes établies, on est passé à la phase suivante : hors la loi. Et le monde médusé peut écouter l’enregistrement d’un appel téléphonique d’une heure au cours duquel le président des Etats-Unis, depuis cette Maison Blanche qu’il ne veut pas quitter, fait pression sur le responsable des opérations électorales de Géorgie, Etat crucial qu’il a perdu de 11 779 voix. Article réservé à nos abonnés Lire aussi En Géorgie, un « meeting de la victoire » pour Donald Trump avant un scrutin décisif
Donald Trump refuse de perdre ; il affirme à son interlocuteur, Brad Raffensperger, qu’il a en réalité gagné la Géorgie par « des centaines de milliers de voix », « probablement un demi-million », qui lui ont été volées par une fraude massive. Exaspéré par les dénégations du Géorgien et de son conseiller juridique, le président leur intime l’ordre, tel un boss de la mafia, de trouver les voix qui lui manquent pour inverser le résultat de l’élection en Géorgie. « Tout ce que je veux, c’est ça, dit Trump. Je veux trouver 11 780 voix, une de plus que ce qui me manque. (…) Alors, on fait quoi, les gars ? Ça commence à bien faire. »
C’est « encore pire » que le Watergate, juge sur CNN Carl Bernstein, l’un des auteurs des révélations qui firent tomber Richard Nixon. Cet enregistrement devrait être enseigné dans tous les cours de science politique, pour montrer que la démocratie est mortelle. Qu’elle ne tient parfois qu’à un fil : celui-ci s’appelle Brad Raffensperger, un homme sec aux cheveux gris, élu républicain comme son président – qui ne manque pas de le lui rappeler – mais respectueux du droit et de sa conscience, assisté d’un jeune juriste droit dans ses bottes, Ryan Germany (« joli nom de famille », note le président au passage). Article réservé à nos abonnés Lire aussi Donald Trump fait pression sur le secrétaire d’Etat de Géorgie pour « trouver 11 780 voix » Une démocratie incroyablement vulnérable
Que se passe-t-il si le fil lâche ? C’est la question que se posent sérieusement aujourd’hui des experts comme l’historien de Harvard Alexander Keyssar, auteur d’un livre récent sur le collège électoral. Dans le Washington Post, il reconnaît que, depuis un mois, « il est devenu beaucoup plus facile d’envisager » que, lors d’une prochaine élection présidentielle, un Congrès dont les deux Chambres seraient contrôlées par les républicains (actuellement seul le Sénat l’est) puisse invalider la victoire d’un président démocrate. « Je trouve cela très inquiétant, ajoute le professeur. Très dérangeant. »
L’hypothèse est d’autant plus plausible que treize sénateurs républicains, emmenés par Ted Cruz, et la moitié des membres républicains de la Chambre des représentants ont décidé de ne pas voter la certification des résultats de l’élection présidentielle, mercredi 6 janvier. Ce vote du Congrès est, traditionnellement, une formalité. Mais, sous Donald Trump, plus rien n’est traditionnel. Le Parti républicain est déchiré entre ceux qui continuent de faire croire à leur base que l’élection du 3 novembre lui a été « volée » et ceux qui refusent de mettre en danger l’ordre constitutionnel. Sur Twitter, Donald Trump a promis « l’infamie » à ces derniers. Article réservé à nos abonnés Lire aussi Les manœuvres et l’obstination de Trump à nier sa défaite déchirent les Etats-Unis
Les « infâmes » étant suffisamment nombreux pour voter avec les démocrates mercredi, l’élection de Joe Biden devrait être certifiée. Mais le scénario cauchemar qu’échafaudaient à l’automne, sans trop y croire, certaines chancelleries européennes, celui d’une transition chaotique à Washington aux conséquences incontrôlables en cas de victoire étroite de Joe Biden, est en train de se réaliser, alors même que la victoire du démocrate est on ne peut plus nette. Ce scénario est si effrayant que les dix ex-secrétaires à la défense actuellement en vie, démocrates et républicains, ont pris l’initiative sans précédent de lancer une mise en garde, dans le Washington Post, contre le recours à l’armée « pour résoudre des conflits électoraux, qui nous emmènerait en terrain dangereux, illégal et anticonstitutionnel ».
On en est là, en 2021, aux Etats-Unis. Donald Trump n’était pas une parenthèse. On l’a pris pour un roi de l’immobilier, génie de la télé-réalité déguisé en populiste, qui s’assagirait en endossant les habits présidentiels. Les solides institutions américaines et leurs fameux garde-fous baliseraient ses velléités de sorties de route. Cela a en partie marché, et il a perdu l’élection. Mais même s’il finit par évacuer la Maison Blanche le 20 janvier, il laissera derrière lui une démocratie incroyablement vulnérable, un paysage politique miné par le mensonge, 74 millions d’électeurs avides de revanche ou désorientés, et une armée de convertis républicains prêts à poursuivre son combat dès 2022. Puisse cela servir de leçon à toutes les démocraties.




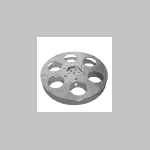
Le Jour de Qingming au bord de la rivière 清明上河图-法语

 Rimes hivernales
Rimes hivernales