



En 2021





|
La cinquième vague de la covid déferle sur l'Europe

En 2021 

|
La collection permanente |
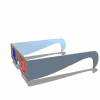
|
Le passage du train a familiarisé ses habitants, imprégniés de tradition, aux usages urbains et à la langue française. Sa luminosité marine est source d'inspiration incessante pour les artistes. Son atmosphère est unique et ses motifs pitoresques : le Bois d'Amour, la chapelle de Trémalo, le port, les moulins. Nommer Pont-Aven, c’est évoquer la Bretagne et la peinture. La ville donne son nom au mouvement créé par Gauguin et Bernard, l’École de Pont-Aven.




Pont-Aven attire les artistes voyageurs dès 1850. À la suite des pionniers américains, les peintres affluent, en quête d’une nature intacte et d’une civilisation réputée rurale. La qualité de l’accueil est une raison déterminante pour la fixation de la colonie artistique : chambres, ateliers et modèles se trouvent facilement. L’une des plus célèbres hôtesses est Julia Guillou, propriétaire de l'Hôtel des Voyageurs puis de l'hôtel éponyme. La Pension Gloanec fut également un lieu privilégié de rassemblement. Ce contexte favorisa la création, comme en témoignent les décors de salles réalisés par les artistes.


L'École de Pont-Aven est le nom donné a posteriori au groupe d'artistes très différents qui sont venus régulièrement peindre à Pont-Aven à partir de 1888. À la Pension Gloanec, autour de Paul Gauguin, gravite une «colonie» d’artistes : Charles Filiger, Meijer de Haan, Claude-Émile Schuffenecker, Armand Seguin, Wladyslaw Slewiñski... L'image qui se dégage du groupe n’est pas celle d’un maître entouré de ses élèves, mais plutôt une mise en commun d'idées et d’esthétiques personnelles et novatrices, en marge de l’enseignement officiel. Les artistes peignent ensemble et leurs œuvres sont nourries par leurs échanges théoriques sur l'art. Le peintre acquiert «le droit de tout oser» selon les mots de Gauguin.
En tant que mouvement artistique L'École de Pont Aven fut principalement active de 1888 à 1894, et elle a regroupé des peintres tels que Gauguin, Bernard, Sérusier et Filiger qui ont influencé une large part du Symbolisme et de l’Art Nouveau. Cette esthétique s’appuie sur l’abandon de la copie fidèle de la réalité et sur la création de l’œuvre d’après le souvenir du sujet que l’artiste garde en mémoire. L'œuvre produite transcrit la vision subjective du peintre ; elle reflète ses émotions au moment où il l’a peinte. La technique fait appel aux aplats de couleurs pures, à l’absence de perspective, aux motifs entourés de cernes sombres et à une composition géométrique qui élimine le détail et le superflu.

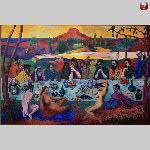


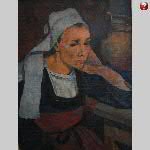

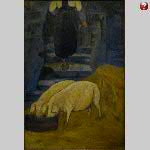

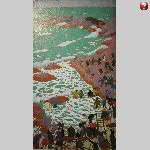
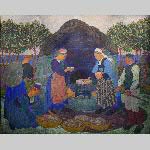

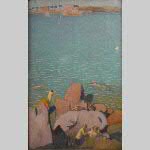

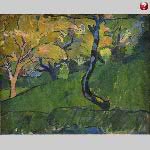
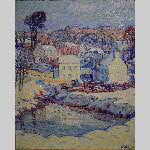
Visite du musée de Pont-Aven

 Un mercredi midi, à l'Amplardais
Un mercredi midi, à l'Amplardais