Pour meubler le confinement, Télérama nous a offert une exposition virtuelle « Rembrandt, Rubens, Van Gogh… Cent tableaux à voir et à revoir ». La première partie (dans l'ordre où je les ai vues) est consacrée aux paysages.
Rembrandt, Rubens, Van Gogh… Cent tableaux à voir et à revoir
Chacun a, quelque part, son musée imaginaire. À l’heure où rouvrent enfin les musées, voici le nôtre : vingt natures mortes, vingt portraits, vingt tableaux religieux, vingt paysages et vingt tableaux de genre. Une sélection éminemment subjective, évidemment imparfaite, dictée par la seule émotion.
Déambulation picturale en cinq galeries.
Ce n’est pas un musée de peintures idéal. Beaucoup d’œuvres majeures manquent – celles de Jérôme Bosch, pour ne citer que lui. C’est un choix dicté par la mémoire, où se mêlent les tableaux vus au gré des expositions et des voyages. Il est arbitraire, subjectif, imparfait, contestable. Il témoigne d’une passion. En cherchant bien, chacun de nous possède son musée imaginaire, quelques images rangées au fond de soi, souvent liées à une anecdote, à un lieu, à un souvenir, à un visage. Parfois même une carte postale y est associée, mais malgré cela, le plus souvent, les images disparaissent, oubliées. Ce musée est un prétexte à se remémorer les émerveillements fugaces qui jalonnent notre vie, comme la jalonnent les paysages entrevus ou ce que Georges Bataille appelait « le miraculeux » et qui n’est souvent, disait-il, qu’un rayon de soleil gracieux éclairant une ruelle. Son image sur un écran n’est pas une fin en soi mais une invite à déambuler dans les musées de nouveau ouverts, une invite à regarder, à prendre son temps – à le perdre même. L’art, pour exister, réclame de la lenteur. Ce musée est aussi une façon de réapprendre à être lent.
Sa composition en cinq parties a commandé un classement reprenant à peu près, et pour simplifier, celui des genres de peinture établis en 1667 par l’architecte André Félibien, devenu pour trois siècles la doxa de l’Académie : la peinture de genre – le grand (histoire et mythologie) et le petit (scènes intimes et quotidiennes) –, le portrait, la peinture religieuse (pour Félibien, comprise dans la peinture d’histoire), le paysage et la nature morte. Mais nous avons exclu, contrairement à Félibien, toute hiérarchie. Ici, la nature morte n’est pas, loin de là, le parent pauvre et vulgaire du musée et la peinture d’histoire, son trésor.
Les absents n’ont pas toujours tort
Tous les tableaux se valent, bien sûr, quelle que soit l’époque de leur conception. Pour une véritable œuvre d’art le temps n’existe pas. Nous nous sommes arrêtés, par prudence peut-être, plus sûrement par la nécessité de maintenir un cadre, à l’art moderne, oubliant volontairement la multiplication des médiums et le foisonnement des attitudes caractérisant l’art postmoderne – ou contemporain. Nous avons aussi laissé dans leurs grottes les peintures rupestres qui auraient à elles seules mérité un genre singulier. La peinture asiatique, dont nous avons cité quelques exemples, aurait également mérité un genre pour elle seule – un musée même ! –, en particulier les shanshui, les peintures de paysage. Quant à la sculpture, elle devrait faire l’objet d’un musée entier où figurerait alors l’art premier. Nous sommes donc partis de l’Antiquité, timidement, pour nous fixer ensuite sur des œuvres conservées pour la plupart dans les musées des Beaux-Arts – ou d’art ancien. C’est un autre choix, lui aussi discutable.
Il est maintenant très difficile de ne retenir, parmi toutes les merveilles peintes du monde, que vingt natures mortes, vingt portraits, vingt tableaux religieux, vingt paysages et vingt tableaux de genre. Le principe mène forcément à l’exclusion. Jérôme Bosch manque, c’est vrai, mais quel tableau ôter de la liste afin que Le Jardin des délices figure dans ce musée ? Certains trouveront ainsi scandaleux l’absence de La Joconde, de Léonard de Vinci, auquel il est cependant préféré, pour les portraits, La Dame à l’hermine, du même Vinci. Une même injustice est réservée à L’Agneau mystique, de Jan Van Eyck au profit d’un autre tableau de ce peintre : La Madone au chanoine Van der Paele.
Même s’il s’y tient la plupart du temps, le choix ne suit pas toujours les sentiers battus. Il s’en écarte parfois résolument, en privilégiant La Nativité de la Vierge, du musée d’Asciano, par exemple, offrant le plaisir d’une découverte et, peut-être, le projet d’un voyage en Italie sur les merveilleuses terres siennoises. Ce musée est donc aussi, et surtout, un prétexte à voyager, dans nos souvenirs, dans les livres, dans les images, en des contrées lointaines ou tout près de chez soi, dans les musées, au sein de la peinture – au cœur de l’art.
De Wang Wei à Monet, vingt paysages où promener le regard
De Wang Wei à Monet, vingt paysages où promener le regard
Les premiers paysages dits « purs » (c’est-à-dire peints pour eux-mêmes) de l’art occidental datent du XIVe siècle. Ce sont deux petits panneaux de bois conservés à la pinacothèque de Sienne, datés de 1338 ou 1339, qui n’avaient sans doute qu’une fonction décorative au sein d’un meuble ou d’un retable. C’est pourquoi certains historiens leur préfèrent les tableaux de Joachim Patinir de la fin du XVe siècle, bien qu’ils aient toujours une portée religieuse et morale. Mais le véritable paysage apparaît au XVIIe siècle dans les pays protestants où, privé de la scène biblique qui lui servait souvent d’alibi, le tableau ne montre plus que son décor. Ainsi naît la peinture de paysage que les Français, toujours prompts à hiérarchiser, classeront très vite au XVIIe siècle en deux genres distincts (Roger de Piles) : le paysage héroïque («grand et extraordinaire») et le paysage champêtre («abandonné à la bizarrerie de la nature») ; puis au siècle suivant en trois genres (Claude-Henri Watelet) : le paysage idéal, la vue et le paysage composé, mélange des deux premiers. Les Chinois se contentent d’un seul genre : leshanshui(montagne-eau). Remontant au IVe siècle, il est toujours pratiqué.
Olivier Cena
Les peintres chinois sont les maîtres du paysage, qu’ils ont représenté dès le IVe siècle sous le nom de shanshui (montagne-eau), et sur lequel ils calligraphiaient un poème. Wang Wei fut au VIIIe siècle le grand lettré de la dynastie Tang (618-907), à la fois poète, peintre, musicien, théoricien et homme politique. Proche du bouddhisme, il était un amoureux inconditionnel de la nature. Il est l’inventeur du paysage monochrome à l’encre noire, le lavis, qui deviendra après lui le modèle de la peinture chinoise de paysage. Tous les lettrés, de toutes les époques, l’admirent et le reconnaissent comme le plus grand d’entre eux. Il reste malheureusement peu d’exemples de son immense talent. Son œuvre picturale fut surtout transmise par des copies. Cette cascade, conservée au temple Chishaku-in, à Kyoto, au Japon, lui est attribuée.

Le 14 mai 1494, Dürer épouse Agnès Frey à Nuremberg. À l’automne, il part pour son premier voyage en Italie où il doit retrouver son ami Willibald Pirckheimer, juriste et humaniste allemand, futur conseiller de Charles Quint, qui étudie alors la philosophie, la géographie et les mathématiques à Pavie. Il se rend à Venise. Trente est sur son chemin – il peignit la ville sans doute lorsqu’il revint en Allemagne, pense-t-on. Il en fait cette vue à l’aquarelle, d’une grande élégance. L’art du pur paysage n’existe pas encore et seuls quelques dessins, des esquisses, préparent aux tableaux où viendra se nicher une scène biblique. En Italie, Dürer découvre les nouvelles théories de la Renaissance, le concept d’une beauté idéale. Il en revient profondément troublé. Aussi n’est-il pas surprenant qu’un peintre, dont le socle esthétique vient d’être bouleversé, trouve dans la contemplation de la nature le calme nécessaire à sa réflexion.

Le tableau porte plusieurs noms : Traversée du monde souterrain, Paysage avec la barque de Charon, Passage du Styx, Charon traversant le Styx – c’est ce dernier que le musée du Prado, à Madrid, où il est conservé, lui donne. Il représente le delta d’un fleuve qui s’achève dans la mer au centre, au paradis à gauche et en enfer à droite. On considère Patinir comme l’inventeur du paysage en Occident, peut-être parce que Dürer disait de lui qu’il était « un bon peintre de paysages ». Il y eut avant lui les arrière-plans des peintures grecques et romaines et des miniatures médiévales, ou à Sienne, en Italie, la fresque d’Ambrogio Lorenzetti Allégorie et effets du Bon et du Mauvais Gouvernement (1339). Mais dans le paysage teinté de mythologie, Patinir excelle. Il s’y montre magnifique coloriste, usant d’une gamme de bleus et de verts d’une très grande richesse et de transparences subtiles suggérant des profondeurs vertigineuses.

La Bible est évidemment ici un alibi, un prétexte à représenter ce que d’aucuns appellent une scène de genre mais qui pourrait bien être un véritable paysage urbain – mais aussi un message politique dénonçant les impôts que les Pays-Bas doivent alors payer à l’Espagne. Marie, Joseph, Jésus bébé caché sous le manteau, et l’âne fuyant vers l’Égypte figurent bien au premier plan, mais perdus au sein d’une multitude de personnages vaquant à leur tâche quotidienne, les uns tuant le cochon, d’autres chargés d’énormes tonneaux ou de lourds ballots, certains patinant sur la rivière gelée, se livrant à une bataille de boules de neige ou se réchauffant près d’un feu. Ça fourmille ! Et pourtant, fruit d’une composition admirable où le moindre détail, le plus petit oiseau tiennent une place capitale, tout y est harmonieux, évident et simple. C’est une magistrale leçon de peinture.

Né à Anvers, formé par Jan, le fils aîné de Pieter Bruegel l’Ancien, appelé en France en 1621 afin de décorer la Grande Galerie du Louvre, maître à Paris, entre autres, de Philippe de Champaigne, Jacques Fouquières demeure peu connu, sans doute parce que l’ensemble des tableaux qu’il peignit pour Louis XIII se trouvaient aux Tuileries lorsque le palais fut incendié par les communards en 1871. Parmi les quelques œuvres qui échappèrent au désastre figure ce paysage, actuellement au musée d’Arts de Nantes, où l’on voit l’héritage des grands Flamands, de Bruegel et surtout de Patinir. La lumière typique du Nord y est subtilement rendue par la transparence des coloris. Moins glorieuse est la façon dont Fouquières, en 1640, se joignit à Simon Vouet pour tenter de discréditer Nicolas Poussin auprès de Louis XIII, intrigues qui poussèrent Poussin, écœuré, à repartir à Rome deux ans plus tard.

On ne connaît que deux paysages peints par le Greco : l’énigmatique Vue et plan de Tolède (vers 1610-1614) et cette Vue de Tolède (vers 1596-1600). Les autres vues de la ville où vivait le Greco, comme dans Le Saint Joseph et l’Enfant Jésus (1597-1599), sont des arrière-plans. Celle-ci est particulièrement curieuse, presque cézannienne. Le Greco y mélange les points de vue et, par conséquent, dans cette vue censée montrer l’est de la ville depuis un point situé au nord, on ne devrait pas voir la cathédrale, l’Alcazar devrait être ailleurs, le cours du Tage a été détourné et les reliefs accidentés exagérés. Il joue aussi avec les distances, révélant des détails que seul un œil proche devrait pouvoir distinguer. Comme Cézanne, il est partout à la fois : en haut de la colline, sur le pont, au pied des arbres, etc. Le sublime ciel d’orage restitue le sentiment de grandiose que cette perturbation météorologique suscite. Voilà l’un des plus beaux paysages peints du monde !

La plupart des paysages de Rembrandt furent peints entre 1649 et 1665. Ils possèdent tous une singularité : l’extrême difficulté de les situer, à la fois dans l’espace (le lieu) et dans le temps (la saison). Le premier d’entre eux, ce Pont de pierre conservé au Rijksmuseum d’Amsterdam, date probablement de la fin des années 1630. On ignore à peu près tout de lui : le nom de la rivière, celui du village dont on aperçoit, dominant les arbres, le clocher de l’église. On peut imaginer qu’il s’agit d’une sorte de paysage type, savamment recomposé à partir de bouts de nature observés par Rembrandt dans le but de restituer une sensation lumineuse, un émerveillement qu’à notre tour nous éprouvons. En effet, le ciel menaçant, où les bleus et les gris sont voilés d’une nappe orangé brun, est magnifique ; la lumière, marquée par l’effet dramatique du rayon trouant les nuages anthracite et éclairant théâtralement l’arbre au centre du tableau, est somptueuse.

Évidemment, les couchers de soleil de celui que les Britanniques appellent avec beaucoup de respect Claude sont les tableaux les plus connus. Ils y voient le précurseur de William Turner. Mais, malgré leur immense qualité, ils flirtent souvent dangereusement, comme Icare avec le soleil, avec le chromo lumineux. Et puis Le Lorrain est un dessinateur d’arbres époustouflant, sans égal pour faire sentir le moindre souffle du vent dans le feuillage. Un talent que l’on retrouve dans ce tableau conservé au Metropolitan de New York, représentant au loin la demeure près de Rome de la famille Crescenzi, sans doute commanditaire de l’œuvre peinte vers 1650. Dans ces fermes, on pratiquait l’élevage de bovins – représentés en bas et à droite du tableau. De cette commande destinée à montrer l’opulence de la famille Crescenzi, Le Lorrain fait, dans une gamme de verts sublime, sous un ciel d’une pureté idyllique, un magnifique poème pastoral.

Nicolas Poussin n’a jamais peint véritablement un paysage sans y introduire un sujet mythologique. Ici, il s’agit du chapitre 2 du Livre de Ruth, où la jeune femme demande à Boaz, qui deviendra son mari et le père de son enfant, Obed, grand-père de David, de la laisser glaner des épis de blé. La scène se passe donc en été au moment des moissons. Le tableau appartient au cycle des Quatre Saisons, conservé au Louvre, peint entre 1660 et 1664 pour le duc de Richelieu, neveu du cardinal. Le paysage est romain mais la lumière conserve la douceur de la Normandie, où naquit le peintre. Nous sommes en été certes, mais, plutôt que la lumière poudreuse qu’implique cette saison, Nicolas Poussin nimbe la toile d’un très léger voile ocré et roux – la lumière de l’automne qui, telle une promesse de fraîcheur et de chatoyance, vient enluminer déjà la touffeur estivale.

Il est des amitiés inexplicables. Ainsi chaque visite au palais des Beaux-Arts de Lille passe immanquablement par ce paysage de Jacob Van Ruisdael, grand maître du paysage hollandais du XVIIe siècle, moins puissant et spectaculaire que ses marines où l’on voit sous des ciels déchaînés les navires chahutés par les vagues, mais montrant une délicatesse lumineuse remarquable. C’est une journée d’été puisque le champ est en partie moissonné. Sur la route sinueuse, un homme et son enfant précèdent un cavalier accompagné de son chien. Au premier plan un arbre mort couché semble nous rappeler la fragilité de notre existence, mais la paix et l’harmonie règnent. Le ciel immense, nuageux, calme, est traversé par un rayon de soleil qui vient éclairer le champ et le chemin devant le cavalier. Ici, la vie est belle.

Depuis Marcel Proust, qui considérait la Vue de Delft comme le plus beau tableau du monde, il est devenu impossible d’y penser sans penser aussi à l’écrivain Bergotte, personnage de La Recherche qui meurt en l’admirant. Tous les visiteurs du Mauritshuis à La Haye cherchent en le voyant le fameux « petit pan de mur jaune » qui fut fatal à l’écrivain et que nul ne trouve puisqu’il s’agit en fait d’un toit à droite de l’œuvre. On ne connaît de Vermeer que deux paysages, cette veduta (large paysage urbain) et La Ruelle. Respectant les codes de la peinture néerlandaise, il fait un ciel immense (à peu près les deux tiers de la toile), mais peint son reflet dans la Schie, accompagné de l’ombre spectrale des bâtiments qui ajoute une note dramatique, appuyée par le nuage sombre. De cette note naît le sentiment que la quiétude que suscitent les promeneurs déambulant sur la grève de sable blond rosé ne pourrait être qu’une apparence.

Voici l’exemple même du tableau romantique, mais d’un romantisme quasi philosophique car le sujet n’en est pas le paysage que cet homme, de dos (un moine selon le titre de l’œuvre), observe, c’est le romantisme même. Ce n’est pas le salut majestueux de Courbet à la grandeur de la nature de 1854 (Le Bord de mer à Palavas), c’est quelque chose qui nous dépasse, un horizon surmonté d’un ciel en dégradé de verts (Friedrich a même supprimé les petits bateaux qu’il avait peints à l’origine), la démesure et rien à la fois. Dans cette œuvre peinte vers 1810 et conservée à la Alte Nationalgalerie de Berlin, la nature est plus grande que l’homme et plus grande encore que les croyances de l’homme. « Vanitas vanitatum omnia vanitas » (Vanité des vanités, tout est vanité), dit l’Ecclésiaste dans la Bible, et le peintre paraît ici illustrer cette célèbre maxime en nous confrontant à un monde angoissant, menaçant mais d’une extraordinaire beauté.

Ce n’est qu’une simple étude, mais elle résume l’art de Constable, l’un des plus grands paysagistes de l’histoire de la peinture. Ici, dans cette huile sur papier conservée à la Royal Academy de Londres, le peintre anglais s’attache à saisir la pluie s’abattant sur la plage de Brighton, non seulement l’averse et le ciel en courroux mais aussi le mouvement du vent et la lumière changeante selon ce mouvement. Ce fut l’une de ses obsessions : les lumières, leur variation selon les saisons et le temps (ainsi les tableaux représentant la cathédrale de Salisbury qui, dans le souci pictural, sont peu éloignés de ceux représentant la cathédrale de Rouen par Monet). Constable ne cesse d’observer la nature – on lui reprocha même de ne peindre qu’elle, sans personnages. Dans cette esquisse hâtive, il y a déjà tout : le clapotis des vagues, le grondement du tonnerre, le coup de vent soulevant le sable rosé et la profondeur poétique du peintre.

Il y a, au centre, un bateau à vapeur pris dans la tourmente et dont on ne distingue que l’ombre de la coque, la roue à aube actionnée par la vapeur et le mât autour duquel un éclair dessine une voile de lumière blanche. Rien ne distingue l’eau de l’air tant le navire semble emporté dans un tourbillon d’ocres – les vagues qui se déploient en rouleaux gigantesques. Une légende s’attache à ce tableau, colportée peut-être par le peintre lui-même. Embarqué sur un navire, L’Ariel, parti de Harwich, il aurait demandé aux marins de le ligoter au mât afin d’observer la tempête. Le tableau, conservé à la Tate Gallery de Londres, fut peint en 1842, à une époque où Turner est au sommet de son art, reconnu et célébré – il devient trois ans plus tard président de la Royal Academy. De cette époque datent ses tableaux flirtant, comme celui-ci, avec l’abstraction, en particulier Pluie, vapeur et vitesse (1844).

Corot se rend à trois reprises en Italie : de 1825 à 1828 à Venise, Rome et Naples, puis en 1834 de nouveau à Venise et en Toscane et enfin de nouveau à Rome pour un bref séjour en 1843. Cette vue d’Ischia, une île située dans le golfe de Naples que l’on aperçoit au loin dominé par le Vésuve, date de la fin de son premier séjour. Elle montre toute la délicatesse de l’un des plus grands paysagistes français, la qualité de la lumière franche qui blanchit les façades, invente des contrastes, crée des ombres portées colorées, donne la profondeur en semblant s’enrouler, avec l’air, autour des reliefs. Le ciel est admirable, un peu chahuté, ocré au sud de Naples, plus brumeux au nord. La voile blanche d’une petite embarcation précise les proportions et achève le demi-cercle qui commence à l’église du village d’Ischia et promène notre regard dans le tableau que conserve le musée du Louvre à Paris.

Peut-être l’une des plus belles représentations de la pluie, d’une simplicité confondante. La pluie est faite d’une série de lignes tombant selon une oblique légère d’une masse nuageuse noire, se croisant pour former un vague treillis qui n’occulte pas le paysage, mais paraît le recouvrir. L’œuvre appartient à la série des Cent Vues d’Edo que Hiroshige exécuta entre 1856 et 1858, l’année de sa mort. Ce sont des gravures sur bois, relevant du genre meisho-e désignant les peintures de paysages japonais inspirées de la peinture médiévale chinoise. Hiroshige est le plus grand peintre de ce genre à son époque, lyrique à ses débuts puis peu à peu plus épuré et audacieux dans ses compositions. On le constate dans cette estampe où seul l’arc du pont rétablit l’équilibre d’une image basculée, où le paysage est réduit à un jeu de grisailles à peine contredit par l’eau bleue sous le pont, où le centre de l’image, point de jonction entre la rive et le pont, se situe en dehors de l’image.

C’est l’un des tout derniers tableaux de Gustave Courbet, peint l’année de sa mort, en 1877, et conservé au Cleveland Museum of Art. Il est alors exilé en Suisse, à La Tour-de-Peilz dans le canton de Vaud, à la suite de la répression contre les communards, accusé d’avoir démoli la colonne Vendôme, emblème du pouvoir impérial napoléonien. Cette vue impressionnante, dont il a réalisé une étude l’année précédente, à peine troublée par la scène champêtre du premier plan, est à peu près celle qu’il a de la terrasse de sa maison. On y voit, au-delà du lac Léman, le massif des Dents du Midi et le Grammont. Dans une gamme de bleus et de verts, le paysage est grandiose sans toutefois tomber dans le romantisme que pourrait suggérer une nature à la fois somptueuse et hostile. Courbet, dont le ventre « s’avance vers le lac comme un nouveau promontoire », imbibé comme une éponge de vin blanc, ne marche plus. Il regarde.

Le pin à gauche établit la distance et non la perspective car Cézanne ne s’occupait pas de perspective. Il peignait les choses comme il les voyait, souvent comme il voulait les voir en bougeant sans cesse de place et en recomposant le tableau à partir de ces vues différentes. Donc le pin établit la distance entre la montagne Sainte-Victoire et le peintre lui-même installé dans l’ombre de l’arbre. Et ce que peint Cézanne, c’est cette distance, c’est-à-dire ce qu’il y a entre la montagne et lui, autant dire pas grand-chose, de l’air. Mais l’air, c’est aussi ce qui fait que la montagne est ainsi, un peu violette, bleue et ocre jaune. Il porte la lumière selon le vent, les nuages, l’heure du jour, la saison. Il peut troubler, estomper, révéler. À travers la branche du pin qui suit harmonieusement le mouvement des collines (une fiction !), à travers ses aiguilles, il devient poudreux. Le tableau, peint vers 1887, conservé au Courtauld Institute of Art de Londres, est d’une extrême complexité et d’une poésie abyssale.

Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un des derniers tableaux du peintre hollandais, peint quelques jours avant sa mort, mais parce qu’il fallait bien choisir parmi tous ses chefs-d’œuvre. Et puis ce tableau conservé au musée Van Gogh d’Amsterdam résume le génie du peintre : la puissance et la précision de la touche, la somptuosité des coloris, l’extraordinaire mouvement qui l’anime. Sur ce champ le vent se lève, plie les blés et les corbeaux s’envolent en croassant dans le ciel bleu teinté de violet annonçant la fin du jour. Van Gogh peint un crépuscule et c’est pourquoi certains y ont vu une représentation de son état d’esprit suicidaire – il faut bien parfois, autour de la peinture, un peu de romanesque. Mais bien malin qui peut dire avec certitude si ce vert très sombre, presque noir, en haut du tableau est l’orage menaçant, la nuit arrivant ou, plus probablement, les branches d’un arbre à l’abri duquel van Gogh peint. Une énigme demeure : dans le ciel brillent, à peine, deux soleils.

Beaucoup ont prétendu que l’excès caractérisant les tableaux de cette époque (celui-ci, conservé au Minneapolis Institute of Art, est de 1918) était dû à la double cataracte dont souffrait Monet. Ce serait plutôt le contraire : les opérations réussies de 1923 ont altéré sa perception des couleurs. La décoration du pont construit à Giverny, les couleurs des fleurs et des arbres, tout dans le jardin obéissait à un plan très précis dicté par Monet lui-même. Le pont est l’histoire d’une confrontation violente entre des jaunes, des rouges et des verts agrémentés çà et là de quelques touches de bleu clair. Une version plus tardive (celle du Moma de 1920-22) ne joue qu’avec les primaires, jaune, rouge, bleu, laissant à un vert olive le rôle subalterne. La touche ample, puissante, hâtive, ajoute encore au chatoiement de l’œuvre, à son aspect volontairement confus. Nous sommes à la lisière de l’abstraction, au cœur de la somptuosité, dans la peinture pure !

Du Caravage à Picasso, vingt natures mortes qui vivront pour toujours
Du Caravage à Picasso, vingt natures mortes qui vivront pour toujours
Dans un livre récent (Pour en finir avec la nature morte, Gallimard), l’historienne Laurence Bertrand Dorléac, confondant nature morte et objets peints, fait remonter le genre à la préhistoire. Il y eut effectivement avant le XVIIe siècle des choses peintes ou sculptées, parfois comme décor, plus souvent pour leur fonction cultuelle. Il y eut aussi des « choses naturelles », comme les nommait Vasari (les fruits et légumes de l’Espagnol Juan Sánchez Cotán, par exemple, dès 1600), mais nous garderons ici la naissance officielle du mot « stilleven », vers 1650 en Flandres, qualifiant les assemblages peints de choses inanimées. La plupart des pays européens ont repris dans leur langue ce mot signifiant « vie silencieuse », sauf la France qui remplaça « nature coite » par « nature morte », par pur snobisme car le genre apparaissait trop vulgaire. Le succès est immédiat. La fonction varie. Dans les pays du nord de l’Europe, la nature morte est moralisatrice, décorative, parfois gastronomique (les « natures mortes de cuisine »), toujours cachée derrière une lecture symbolique. En Espagne, elle est soit paillarde (les bodegón), soit profondément religieuse (Zurbarán). En France – et bien que l’un des plus grands peintres de natures mortes, Chardin, soit français –, elle reste méprisée jusqu’à ce que l’art moderne lui donne enfin ses lettres de noblesse.
Olivier Cenna
On ne sait pas grand-chose de ce moine bouddhiste chinois qui vécut au XIIIe siècle. Muqi est probablement un pseudonyme et Fachang son nom monastique. Peintre de portraits et de paysages, on lui doit cette énigmatique nature morte, une encre sur papier conservée au musée Daitoku-ji à Kyoto, au Japon. Énigmatique parce que les fruits du plaqueminier ne reposent sur rien et pourtant ils nous semblent posés, en parfait équilibre. Leur forme est aussi sujet à la glose. Pourquoi le premier et le sixième sont-ils « vides » ? Pourquoi leur apparence diffère-t-elle ? Et, s’il en va du plus jeune au plus mûr, est-ce une méditation sur la vie, une sorte de vanité ? Nul ne le sait. L’œuvre conserve son mystère. Et surtout son pouvoir de fascination, cette beauté évidente, simple, née de quelques taches d’encre noire en apesanteur, que l’on retrouvera sept siècles plus tard dans certaines œuvres de Cézanne et de Giorgio Morandi.

On a longtemps cru qu’il s’agissait d’un tableau hollandais – on ne prête qu’aux riches. Mais, en 1919, l’immense historien d’art italien Roberto Longhi l’attribua au Caravage – la corbeille ressemble en effet beaucoup à celle que tient dans ses bras le jeune garçon, dans le tableau que le Milanais peignit vers 1593 peu après son arrivée à Rome. La date d’exécution demeure discutée, allant de 1594 à 1602. À son époque, l’œuvre bouleversa ses propriétaires successifs, les cardinaux del Monte et Borromeo. Elle fut copiée. Comme à toutes les natures mortes de cette époque, on lui attribue une fonction morale. Ce serait une vanité, comme en témoignent les fruits gâtés (pomme et poire) et le raisin trop mûr. Mais cela ne change rien à la fraîcheur de ce tableau conservé à la Pinacothèque Ambrosienne, à Milan, au sentiment de vie qui l’anime, à l’extrême élégance du mur jaune, à l’air qui circule et fait frissonner les feuilles sèches déjà.

Il ne s’agit pas à proprement parler d’une nature morte ; mais ce n’est pas non plus une scène de genre. Les Espagnols au XVIIe siècle utilisent le mot bodegón qui signifie à la fois la taverne où l’on ripaille et la peinture de nature morte. Un bodegón est donc une nature morte ne représentant que ce qui a rapport avec la nourriture et sa préparation. Ainsi cette vieille femme qui cuit des œufs dans sa cuisine rudimentaire est bien une nature morte – d’ailleurs, sur sa table, l’alignement des objets, leur autonomie et leur éclairage rappellent les tableaux de Zurbarán. Velázquez a peint cette toile, aujourd’hui conservée à la National Gallery d’Édimbourg, en Écosse, en 1618, peu après son examen de peintre. Il démontre sa virtuosité dans le soin porté aux détails – l’onctuosité du blanc des œufs cuisants. La lumière franche, chaude plonge la scène apparemment triviale dans un clair-obscur qui ajoute une tension et renforce la dignité déjà affichée dans les visages sévères des deux personnages qui ne se regardent pas.

Pieter Claesz fut le plus célèbre peintre de natures mortes de son temps (il n’a jamais peint autre chose), inventeur avec Willem Claeszoon Heda du tableau monochrome (des camaïeux de gris ou de bruns). Il passa toute sa vie à Haarlem, aux Pays-Bas. Claesz se distingue de ses contemporains par la perfection de ses compositions, à l’époque novatrices. Jusqu’alors, la nature morte avait horreur du vide (les « repas servis » montraient des tables débordantes d’objets entassés). Claesz, au contraire, laisse des espaces autour du motif et construit son tableau à partir d’un système de diagonales complexe comme on peut le constater sur cette œuvre de jeunesse (1628) conservée au Metropolitan de New York. Cette dernière est une Vanité, genre en vogue à l’époque baroque, surtout en Hollande où il se développe à partir des années 1620. Elle est d’essence philosophique : le livre, la plume et les feuilles évoquent les grandes questions métaphysiques et ontologiques dominées (le crâne est posé sur le livre et les feuilles) par la seule certitude que nous avons : la mort.

Voici à nouveau un tableau énigmatique, conservé au Norton Simon Museum, à Pasadena, qui se prête aux interprétations. Puisque Zurbarán fut un immense peintre religieux (ses merveilleux saint François), on fait donc de cette nature morte des lectures symboliques et chrétiennes. Ainsi, pour certains le peintre espagnol aurait représenté la Sainte-Trinité. Pour d’autres, seraient réunis ici symboliquement les attributs de la Vierge, comme la pureté (la tasse d’eau) ou l’Immaculée Conception (la rose sans épines). Ce qui est certain, c’est que Zurbarán, contrairement à ce que fera plus tard Chardin, ne fait pas dialoguer les choses, ne les rapproche pas, mais les peint indépendamment les unes des autres. Seule la lumière, venant de biais de la gauche, les réunit. Aussi, de l’autonomie de chacun des trois groupes, de leur alignement parfait, du clair-obscur dramatique qui les révèle, naît un sentiment de sacré qui impose le silence.

La peinture hollandaise créa la peinture d’objets et de choses inanimées au XVIIe siècle sous le nom de « vie silencieuse », plus juste que celui de nature morte. Il y eut de sa part beaucoup d’excès, un trop-plein d’objets représentés, des virtuosités gratuites, un mélange douteux entre le religieux et la mangeaille, un concours de kitsch et, rarement, un espace poétique. Jan Van de Velde III, spécialiste du genre, s’y montra plutôt réservé, sans prétention et parfois, comme dans ce tableau conservé au Rijksmuseum, à Amsterdam, inspiré, proche du maître Pieter Claesz. Curieusement composée selon un triangle dont la pointe se trouve à droite, au bout de la table près de l’huître, l’œuvre offre quelques bonheurs : un plissé savant, un joli reflet dans le pot d’étain révélant une fenêtre, une porcelaine élégante et une lumière discrète et caressante. Jan appartenait à une dynastie de peintres qui débuta avec son grand-oncle Esaias, paysagiste renommé, et s’achève avec lui.

Il existe deux versions contemporaines sur ce thème : celle-ci, conservée au Louvre, et celle du musée de Budapest, jadis attribuée au maître néerlandais mais aujourd’hui prudemment donnée à son atelier. Le mérite de la seconde est de préciser qu’il s’agit bien de l’arrière-boutique d’une boucherie, ce que le clair-obscur de la première ne laissait que supposer. Car ce qui frappe ici, c’est le cadrage serré sur la carcasse que certains voudraient voir pourrissante, mais qui n’est que dépouillée et dans l’attente du désossage, ce que confirme l’écarteur sur le thorax de la bête. Rembrandt restitue grossièrement l’anatomie, préférant dans l’amas des chairs et des organes le jeu de rouges (roux) et de jaunes (paille), jeu que reprirent au XXe siècle Chaïm Soutine, dans plusieurs interprétations, et Bacon, qui fit de la carcasse les ailes d’un pape. La nature morte n’était pas le domaine préféré de Rembrandt. Mais, comme se le demande la jeune femme qui, en arrière-plan, regarde la scène, est-ce bien une nature morte ?

Jean-Baptiste-Marie Pierre fut un imbécile. « Sa morgue s’est accrue à mesure que son talent s’est perdu », écrivait Diderot à son propos. Devenu en 1770 premier peintre du roi Louis XV et directeur de l’Académie, il écarta Chardin, qui mourut neuf ans plus tard dans l’indifférence générale. Comment un peintre pouvait-il ne pas s’émerveiller devant la poésie des natures mortes de Chardin est un mystère. L’idéologie voulait alors que le genre soit vulgaire. Le brave Siméon s’en contenta, avec une élégance, une grâce inouïes. Ces quelques fruits, par exemple, deux pêches et cinq prunes, rappellent la simplicité des kakis de Muqi. Une même poésie habite les deux œuvres. Chez Chardin, il n’y a pas de vide, d’apesanteur, mais une densité extraordinaire des fruits. Ils pèsent. La lumière leur offre une vie magnifique : on les sent juteux ! Et, puisque le couteau est absent de ce tableau du musée des Beaux-Arts d’Angers, c’est la queue de la prune de gauche, penchée dans le vide, qui nous invite à entrer dans son univers silencieux.

Meléndez, né à Naples, aujourd’hui considéré comme le plus grand peintre espagnol de natures mortes du XVIIIe siècle, eut très peu de succès de son vivant et mourut dans la pauvreté. Certains le surnomment le « Chardin espagnol », plus pour sa spécialisation dans ce genre alors mineur que pour son style beaucoup plus réaliste et plus cru que celui du Français. Meléndez s’attache à l’exactitude plutôt qu’au sentiment et place ses objets dans une lumière franche, souvent chaude – « torride », disait l’historien d’art Charles Sterling qui trouvait aux tableaux « une objectivité cruelle ». Ce n’est pas le cas de celui-ci, peint en 1770 et conservé au musée du Prado, à Madrid. La douceur des tons (blancs, gris et ocrés) et de la lumière venue de la droite, la composition en légère contre-plongée, la délicatesse des brillances du verre et de l’étain, l’érotisme du morceau de pain allongé sur la serviette blanche comme une Vénus lascive, tout cela suscite l’idée d’une intimité voluptueuse, du plaisir, d’un évident bien-être.

Loin de ses plages aux ciels immenses, des promeneuses élégantes déambulant dans le sable ou des jeunes filles brodant à l’ombre d’un parasol, Eugène Boudin se consacra une douzaine d’années à la nature morte, entre 1853 et 1865. Il commença au Louvre, face au maître du genre, Chardin, qu’il copia avant de se lancer dans ses propres créations où, comme dans ce tableau, peint au milieu des années 1850, conservé au musée d’Art moderne André-Malraux, au Havre, la lumière paraît provenir des légumes eux-mêmes, jaillir de la chair orangée du potiron, des queues blanches des asperges et de la grappe de gousses d’ail posée contre le beurre. Le fond est sombre, peu éclairé – à peine distingue-t-on les feuilles sortant du panier. Deux noix, l’une à droite et l’autre à gauche, placées dans une position précaire, invitent notre regard à entrer dans l’œuvre. Ces « tableaux de salle à manger », comme les qualifiait son auteur, étaient achetés – et parfois commandés – par les bourgeois du Havre. Le surnom est injuste : ils témoignent d’une solide maîtrise et d’un réalisme poétique qui rappellent Courbet.

L’origine de ce tableautin est une histoire à la fois édifiante et jolie. En 1880, Manet vient de peindre une Botte d’asperges (conservée au musée Wallraf Richartz, à Cologne) en réponse à une commande effectuée par le critique d’art Charles Ephrussi, qui désire une nature morte. Le prix en a été fixé à 800 francs, mais le collectionneur ravi du tableau lui en donne 1000. Aussitôt Manet peint une asperge solitaire – ce tableau conservé au musée d’Orsay, à Paris –, et l’offre à Ephrussi, accompagnée d’un mot : « Il en manquait une à votre botte ». Mais alors que la botte peinte, par sa lumière et son fond brun, porte encore le souvenir des natures mortes passées, aussi bien hollandaises qu’espagnoles, l’asperge solitaire, elle, s’en démarque. Manet s’y montre d’une liberté extraordinaire (les coups de pinceau rapides), d’une délicatesse dans les coloris virant à la grâce (les mauve, bleu, vert, jaune) de la tête du légume, d’une audace incroyable (le ton sur ton de la queue sur la table de bois blond), et témoigne d’une poésie subtile et douce. Oui, comme le disait Georges Bataille, « ce n’est pas une nature morte comme les autres ».

Le tableau est officiellement daté de 1886, lorsque Gauguin se trouve à Pont-Aven où il rencontre cette année-là le peintre Charles Laval qui devient son ami. La présence de la curieuse sculpture que Laval regarde, un vase dont l’embouchure s’achève en fleur d’iris, laisse penser que le tableau est un peu plus tardif – la fin de l’année – puisque Gauguin façonne le vase à Paris après son séjour breton. L’année suivante, le peintre et son ami Laval s’embarquent pour Panama afin de travailler au creusement du canal, et, malades, se réfugient en Martinique où le Centre d’interprétation Paul-Gauguin, au Carbet, conserve le souvenir de leur escapade. Dans ce tableau, propriété du musée d’Indianapolis, aux États-Unis, Gauguin ordonne les pommes comme le ferait Cézanne (Compotier, verre et pommes, de 1880), s’inspire des pastels de Degas (le portrait de Laval) et surtout de la peinture de Laval lui-même qui influença beaucoup Gauguin, au point que l’on attribua à ce dernier des petits paysages de Laval. Ainsi le fond du tableau très « lavalien », magnifique, fait d’arabesques et de figures géométriques décoratives.

Ce tableau apaisé fut peint par Van Gogh en janvier 1889, au sortir de l’hôpital d’Arles où il avait été admis le 25 décembre 1888 après s’être coupé l’oreille dans un accès de folie. Sur la table, à côté des oignons, surmonté même par l’un d’entre eux, se trouve L’Annuaire de santé, de François-Vincent Raspail dans lequel le chimiste et botaniste donnait ses conseils d’hygiène – que Vincent suivait – afin d’éduquer le peuple à la santé. La bouteille de vin est vide et la pipe froide. Une enquête approfondie a révélé que l’enveloppe est celle d’une lettre ayant contenu de l’argent envoyé par son frère Théo. Quatre couleurs dominent : bleu clair, vert, jaune et orange, auxquelles s’ajoutent le rose de la couverture de l’annuaire et le brun roux de la cire à cacheter, près de la boîte d’allumettes. Ces couleurs sont douces, délicates et subtiles (l’ombre bleu pâle). Leur harmonie témoigne d’un calme malheureusement momentané. On a voulu voir dans ce tableau conservé au musée Kröller-Müller, à Otterlo, aux Pays-Bas, un autoportrait. Mais que ce ne soit qu’une simple observation de la réalité suffit à notre bonheur.

C’est un tableau merveilleux, peint vers 1890, peut-être un petit peu avant puisqu’il n’est pas encore marqué par le synthétisme vers lequel cherche à l’emmener Paul Sérusier et qui aboutira en 1891 à L’Intérieur vert. Il n’y a là aucun recours à la mémoire et très peu à l’imagination – dans les coloris, peut-être, en particulier dans l’étonnante présence d’un vert sapin sur la lame du couteau. Le jeune Vuillard peint ce qu’il voit : les restes de son déjeuner, sans doute frugal, fait d’un bout de fromage et d’un verre de vin. La table, de guingois (elle remonte après la bouteille), est faite d’une succession de touches ocre et mauves (on pense évidemment à Cézanne), et l’on trouve déjà les coloris de prédilection du peintre : les verts (la bouteille de vin et le reflet sur la vitre de la fenêtre opalines, le mur tacheté de vert d’eau, de vert lichen et de sinople, etc.) et sur la table, en bas et à droite, ce mélange harmonieux de rose, de gris, d’ocre jaune, de rouge sombre et de vert tilleul. La lumière, comme dans ses nombreux intérieurs, est d’une douceur infinie suscitant l’idée, malgré le dénuement, d’un grand bonheur de vivre.

On doit à Cézanne la réintroduction du crâne (en 1866 dans Crâne et chandelier), qui avait disparu au XVIIIe siècle, dans la peinture moderne. L’Aixois reprend à son compte la tradition de la vanité, apparue en Hollande vers 1620, mais lui retire toute signification métaphysique ou religieuse : le crâne est ainsi, à la fois rond comme une pomme (le sommet) et biscornu, baroque, tordu, irrégulier (la face). Dans ce tableau peint en 1898, conservé dans la fondation Barnes, près de Philadelphie aux États-Unis, le crâne est à la fois les fruits (ronds) et le torchon (biscornu). Cézanne le place au sommet d’une composition comprenant des pommes, des poires, un citron, une assiette et un torchon posés sur une table bancale au plateau impossible (l’alignement diffère de chaque côté du torchon). Le fond très sombre (verts, bleus, mauves, bruns) floral met en valeur – et en lumière – les ocres (table, crâne, et la curieuse ouverture triangulaire en haut à droite). Comme dans les Six Kakis de Muqi, les fruits semblent en apesanteur, à la fois posés et aériens. Il y a toujours une puissante magie dans les natures mortes de Cézanne.

Parmi sa collection personnelle de tableaux, Claude Monet possédait peu de natures mortes, juste l’essentiel, un chef-d’œuvre : la Nature morte au pot à lait et aux fruits, de Cézanne, datée de 1900. Lui-même préférait peindre les fleurs qu’il plantait dans son jardin de Giverny. Dans sa jeunesse, il s’était frotté à cet exercice, notamment avec une très élégante Nature morte avec bouteille, carafe, pain et vin (1863) ou avec ce tableau chatoyant conservé au Getty museum de Los Angeles, sobrement intitulé Fleurs et fruits (1869). Ce n’est donc pas encore le Monet impressionniste (plus convaincant lorsque la nature est vivante – les Nymphéas), qui est à l’œuvre. Il y a encore, dans le bouquet, le souvenir de Delacroix, et déjà dans les ombres colorées du raisin la promesse d’une autre peinture. La touche est vive, épaisse, hâtive. La lumière, venue de la gauche, tombe sur la corbeille de poires (presque surexposée, dirait-on en photographie) et évite d’éclabousser le bouquet de fleurs et les autres fruits qu’elle maintient dans une douceur automnale.

Ce n’est pas à proprement parler une nature morte ; et ce n’est pas non plus une scène de genre, ni un paysage même si un bout de nature apparaît par la fenêtre. Cette confusion est au cœur du projet décoratif matissien. Nous ne savons plus ce que nous regardons, incapables de différencier ce qui appartient à la décoration de ce qui est naturel, ce qui est vertical de ce qui est horizontal tant le tableau est surchargé de motifs jusqu’à la saturation, piégé par le jeu de miroir et les fausses pistes, et refuse la règle de la perspective fixée depuis la Renaissance. Au milieu sont trois aubergines posées sur une table recouverte d’une nappe à motifs – les légumes pourraient aussi bien appartenir aux motifs de la nappe. Elles sont comme trois notes de musique : elles rythment et précisent la mélodie chromatique. Ainsi s’annoncent dès 1911, avec cette grande œuvre conservée au musée de Grenoble, les futures et somptueuses gouaches découpées.

En premier lieu, il faut trouver la clarinette. Elle se trouve sous l’amoncellement de choses pour la plupart indéfinissables – on y voit du raisin vert, une poire, un compotier et un verre. On ne découvre donc que son embouchure (en haut) et son pavillon (en bas) d’une couleur beige qui se confond avec une forme de la même couleur. Le tableau, peint en 1927, conservé à la Phillips Collection, à Washington, appartient à la période postcubiste de Braque, lorsqu’il s’éloigne de la rigueur et revient à la couleur, à une figuration plus réaliste tout en conservant des années passées une composition faite de juxtaposition de plans. On le lui a reproché. Certains parlèrent de « retour à l’ordre » ou de « régression ». Au contraire, dans ces natures mortes, qui deviennent durant une dizaine d’années son genre privilégié, il retrouve la sensualité et la poésie qui précédèrent la période de recherche cubiste.

Comme le dieu romain Janus, Emil Georg Bührle, industriel allemand ayant acquis la nationalité suisse en 1937, avait deux visages. Il vendait des armes et achetait des œuvres d’art, beaucoup d’armes (les deux guerres mondiales assurèrent sa fortune) et beaucoup d’œuvres d’art (Van Gogh, Monet, Manet, Picasso, etc.). Parmi ces dernières, figure cette nature morte peinte par Picasso en 1941 et appartenant à la fondation Bührle de Zurich. Cette année-là, Picasso revient de Royan avec sa compagne Dora Maar et s’enferme dans son atelier de la rue des Grands-Augustins. Sa peinture d’alors va d’une déformation violente (l’admirable et grotesque Jeune garçon à la langouste, 1941) à la reprise de la composition par plans désarticulés héritée du cubisme. La nature morte appartient à cette dernière veine. Admirablement colorée et composée, éclairée de telle sorte que, selon la tradition espagnole, chaque objet garde son autonomie, elle est un magnifique exercice de virtuosité.

Une bouteille et trois boîtes suffisent à dire toute la beauté et la poésie du monde. À la mort de Morandi, on découvrit dans sa chambre simplement meublée d’un lit et d’une petite table son matériel de peinture et ces objets qu’il ne cessa d’assembler, variant imperceptiblement les compositions d’une précision absolue. Seule variait la lumière, selon le temps, l’heure, la saison et l’emplacement de la table. Cette lumière tombant sur les objets (ses qualités, ses subtilités, ses teintes) obsédait Morandi comme, tombant sur un étang, elle obséda Monet (les nymphéas), ou sur une montagne, Cézanne (la Sainte-Victoire). Dans ce merveilleux petit tableau, conservé au Morat Institut de Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne, l’absence de clair-obscur, la pâte légèrement granuleuse, les coloris, évoquent les fresques du Quattrocento en partie effacées. Morandi est un médiéval attardé.

De Van Eyck à Matisse, vingt tableaux qui racontent l’histoire (grande ou petite)
De Van Eyck à Matisse, vingt tableaux qui racontent l’histoire (grande ou petite)
Sont regroupés ici la peinture de genre, montrant des scènes familières et anecdotiques, apparue au XVIe siècle en Hollande avec Bosch et Bruegel ; et la peinture de grand genre ou peinture d’histoire comprenant les sujets historiques et mythologiques. Depuis la Renaissance et le classement hiérarchique de Leon Battista Alberti, et comme l’indique l’adjectif qualificatif, la seconde domine la première. Au XVIIe siècle, les académies européennes de peinture reprendront cette distinction. Puis ce sera au tour des Salons d’avantager le grand genre au détriment du (petit) genre et des tableaux de chevalet. Diderot jugeait « superflues » ces divisions académiques que la révolution française fragilisa par la suite. Elles demeurent pourtant jusqu’à la fin du XIXe siècle (l’impressionnisme du point de vue institutionnel n’existe pas face aux grands peintres d’histoire pompiers), et disparaissent au XXe siècle. Reste à savoir si l’art actuel commentant et critiquant l’actualité, défendu par l’institution, placé lui aussi au sommet de la hiérarchie artistique, n’est pas la forme contemporaine et académique de la scène de genre.
Olivier Cenna
Ce que l’on nomme la peinture de genre regroupe les scènes anecdotiques et familières. Elle existe depuis l’Antiquité, mais toujours teintée de religion. Ignorée au Moyen Âge, elle revient au XVe siècle avec Les Époux Arnolfini, de Jan Van Eyck, peint en 1434. Ce tableau, conservé à la National Gallery de Londres, a gardé son titre bien que l’on sache maintenant que Giovanni Arnolfini, un riche marchand toscan vivant à Bruges, n’épousa Giovanna qu’en 1447. Donc on ignore qui est représenté dans cette œuvre mystérieuse et double (il y a la scène que l’on voit et celle, légèrement différente, reflétée par le miroir où le chien et les mains ont disparu), dont le jeu de regards préfigure deux siècles plus tard Les Ménines, de Velázquez. Certains (l’historien Pierre-Michel Bertrand) y voient l’autoportrait de Van Eyck avec sa femme Margareta. Impossible, protestent d’autres, un génie absolu de la peinture ne peut, comme l’homme laid représenté sur le tableau, afficher un air sournois.

La peinture de sujets mythologiques, comme la peinture de sujets historiques ou religieux, appartient à ce qu’on appelait à partir du XVIIe siècle le grand genre. Elle apparaît dans l’art occidental à la Renaissance. Elle correspond à la redécouverte de l’Antiquité, de son art et de ses textes, associée à l’humanisme naissant. D’abord soumis à une lecture chrétienne, les textes s’en affranchissent au XVIe siècle. Ainsi Danaé – enfermée par son père, le roi d’Argos, qui craignait que son petit-fils ne le tue –, d’abord associée au personnage de la Vierge, retrouve son statut d’héroïne mythologique et devient même, sous le pinceau du Titien, un nu. Il existe quatre versions de Danaé peintes par Titien. Celle du musée du Prado, à Madrid, peinte en 1554, ajoute une servante recevant Zeus transformé en pluie d’or à la place du Cupidon de la version de 1544. Mais c’est surtout, avec ses tonalités d’une grande douceur, la plus dynamique, la plus élégante, la plus sensuelle.

Réalisé un an avant sa mort, ce tableau de Bruegel l’Ancien, aujourd’hui conservé au musée de Capodimonte, à Naples, illustre la parabole du Christ citée par les Évangiles de Matthieu et de Luc : « Laissez-les : ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles ; si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse ». La scène, ainsi représentée, se veut à la fois burlesque et morale, politique aussi puisqu’en 1568 débute aux Pays-Bas la guerre de Quatre-Vingts Ans, alimentée par les protestants, qui chassera les Espagnols. Bruegel utilise des couleurs peu contrastées : des bruns et des ocres pour le paysage aride, des gris et des verts froids, un rouge sombre, pour les personnages et un blanc à peine ombré pour le ciel. Comme toujours, l’œuvre est admirablement et très précisément composée. Le musée du Louvre en conserve une copie jadis attribuée à son fils Pieter Bruegel d’Enfer, où le peintre a réchauffé les couleurs, fleuri le paysage, changé le cadrage et, au bout du compte, détruit la composition.

Vers 1615, Maximilien Ier de Bavière fait à Rubens la commande de quatre tableaux décoratifs représentant des scènes de chasse, sujet très populaire à l’époque et associé aux scènes de bataille. D’ailleurs Rubens s’inspire dans sa composition d’une fresque alors disparue de Léonard de Vinci, la Bataille d’Anghiari, dont il a copié une gravure. Quant au sujet de ce tableau conservé au musée des Beaux-Arts de Rennes, il mêle allègrement le personnage biblique de Samson (qui combat le lion) avec des Maures enturbannés et de fougueux cuirassiers bavarois, et des animaux africains (léopard et lion) avec le tigre asiatique. L’exactitude – historique et zoologique – n’a à l’époque aucune importance. Seuls comptent la dynamique, la fougue, l’aspect spectaculaire de la scène, voire sa brutalité. En revanche, Rubens s’est documenté pour représenter de manière très réalistes les animaux sauvages alors invisibles à Anvers. Et surtout, comme le soulignait l’historien suisse Jacob Burckhardt, il s’est abandonné « au plaisir suprême qu’il prenait à toute forme de mouvement ».

On ne sait rien de ce tableau, peint vers 1639. Pierre Landry, un joueur de tennis (et vendeur de tableaux anciens) l’acheta chez un antiquaire vers la fin des années 1920 ; l’historien d’art allemand Hermann Voss le reconnut comme un véritable De La Tour (il est signé) ; on lui trouva un antécédent pratiquement identique (Le Tricheur à l’as de trèfle) ; et en 1972 le musée du Louvre l’acheta à Landry une fortune. Il représente une partie de prime (l’ancêtre du poker) durant laquelle un jeune et riche damoiseau outrageusement accoutré se fait plumer par le tricheur et ses complices : la servante et la courtisane. On prête à ce tableau une grande valeur morale car il montre certaines des tentations que dénonce le Christ dans l’Évangile de Marc : les mauvaises pensées, les vols, la fraude, la débauche, l’immoralité sexuelle, l’orgueil. Il montre surtout un étrange et fascinant mélange de style, entre le visage réaliste du tricheur, le teint de porcelaine du pigeon, et les visages de madones du quattrocento des femmes.

La nuit de ce tableau peint en 1642, conservé au Rijksmuseum d’Amsterdam, est due au bitume de Judée employé en glacis depuis le XVe siècle. Cette couche colorée et transparente dégrade la sous-couche peinte et assombrit peu à peu le tableau. Ainsi la compagnie de la milice bourgeoise des mousquetaires d’Amsterdam fut à l’origine représentée en pleine lumière. L’œuvre n’en demeure pas moins la plus célèbre de Rembrandt. Son organisation dépend du prix que paye chacun des mousquetaires, la présence au premier plan étant la plus chère. Donc les braves bourgeois, armés de leurs pétoires comme des carabins, plastronnent. Mais que viennent faire dans ce tableau la petite fille si bien éclairée, le petit garçon casqué à droite et surtout celui, à peine caché derrière Frans Banninck Cocq, le commandant de la troupe, qui tire un coup de fusil ? Ce sont peut-être les enfants de ces bourgeois qui, comme leurs pères, s’amusent. Ils troublent à peine la construction magistrale où les lignes de forces – diagonales, obliques, verticales, horizontales – intensifient le chahut.

Avant d’être une illustration pour des pots de yaourt, cette servante versant du lait (son titre à l’origine) fut un tableau renommé et même populaire puisqu’il réussit l’exploit d’être toujours connu et admiré alors que son auteur était, lui, oublié. Car Vermeer parvient ici à donner à un épisode de la vie quotidienne une noblesse, une dignité et une poésie extraordinaires – seul, après lui, Chardin parviendra à traiter ainsi une scène de genre. La lumière, délicate, sublime, révèle chaque détail que Vermeer s’est plu à peindre avec un réalisme impressionnant. Ainsi la véritable nature morte au premier plan : sur la table un panier à pain, un torchon du même bleu que le tablier (superbe !), un pot en faïence émaillé (à bière ?) et le plat en terre cuite (grès) dans lequel la servante verse le lait. Ce tableau du Rijksmuseum d’Amsterdam, peint vers 1660, est une merveille mystérieuse puisqu’il épuise toutes les tentatives d’interprétations : religieuse, symbolique, sociale, historique et même sexuelle.

C’est peut-être, avec l’urinoir de Duchamp (Fountain, 1917), l’œuvre d’art la plus commentée au monde, une invitation au discours, une fabrique d’hypothèses, un rêve de philosophe. Un peintre se peint peignant un tableau dont on ne voit que l’image du modèle réfléchie dans un miroir accroché sur le mur du fond de l’atelier. Le tableau, qu’on ne voit pas, représente donc les parents de l’infante Marguerite-Thérèse, présente au premier plan avec ses demoiselles d’honneur (les ménines), qui se situent donc, par rapport au tableau que peint Velázquez, du côté opposé à celui de leur fille. Bref : ce sujet-là fait couler beaucoup d’encre, et maintenant beaucoup de blogs. Il est vrai que Velázquez, à travers le jeu de regards, s’y livre à une profonde réflexion sur la peinture, sur les deux réalités, celle du modèle et celle du tableau, auxquelles se confronte le peintre, et par conséquent sur le pouvoir de l’image et de son créateur. Maintenant, on parlerait moins de ce tableau s’il n’était pas d’une composition complexe et magnifiquement éclairé : la fenêtre (le peintre, l’infante et les ménines), le miroir (le roi et la reine), et la porte (le chambellan, seul témoin de la scène). Car c’est aussi un jeu de lumières extrêmement subtil.

On attribue ce tableau à Louis Le Nain, mais il pourrait aussi être de la main de ses deux frères Antoine et Mathieu. Les trois se sont spécialisés dans la peinture de la vie quotidienne, et particulièrement celle des paysans. C’est un choix sans doute dicté par l’opportunité d’occuper sur le marché une place assez libre. Les Le Nain, venant de la bonne bourgeoisie de Laon, installés dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés où ils partageaient un atelier, n’étaient pas particulièrement marqués par la ruralité. Les expositions passant, les recherches avançant, la renommée de Louis grandit – un « génie méconnu ? » se demandait le Louvre-Lens en 2017. Aussi attribue-t-on cette Famille de paysans à Louis parce que c’est sans doute l’un des plus beaux Le Nain qui soient. Par la grande qualité de la lumière, en premier lieu, dorant ce camaïeu de coloris terreux où dansent les blancs des vêtements et les touches orangées (le feu, la flûte, le dossier de la chaise, la soupière, etc.). Ce tableau, conservé au Louvre, est une partition chromatique, ce que précise le joueur de flûte, où le bleu de la robe sonne comme un bourdon et le verre de vin comme une chanterelle.

Poussin a peint deux tableaux à partir du récit mythologique de Fabius Pictor, relaté par Plutarque, qui raconte comment Rome, sur l’ordre de Romulus, s’est construite en enlevant les femmes des autres villes. Le premier, peint vers 1634-35, est au Metropolitan de New York, et celui-ci, peint environ trois ans plus tard, est conservé au Louvre. Le thème de l’enlèvement est alors populaire. Il apparaît à la Renaissance dans le but, selon l’historien Jérôme Delaplanche, d’affirmer la supériorité du mari sur son épouse. Pour Poussin, c’est surtout l’occasion de représenter une scène de bataille, une profusion de mouvements, du « furieux » disait-il – une fureur dont s’inspirèrent David, Degas et Picasso. Pour les dessins préparatoires, le peintre se servait d’une boîte à perspective, sorte de théâtre miniature où il installait des figurines en cire afin d’étudier les positions des corps et la lumière. Mais il s’illustre aussi par une représentaton des passions humaines lisibles sur les visages : la terreur, la haine, l’envie, la douleur, la compassion même dans le soldat à droite ménageant la vieille femme et pourquoi pas la bêtise, si l’on en juge par l’attitude et le visage stupides de Romulus.

La scène se déroule juste avant le dîner. La soupe va être servie par la mère (ou la servante) dès que ses enfants auront récité le bénédicité. L’enfant assis au premier plan hésite, comme semble le montrer le regard gêné de sa sœur. Derrière sa chaise est accroché le tambour avec lequel il jouait avant de passer à table. La mère attend, patiente, le visage plus renfermé et sévère sur ce tableau du Louvre que sur celui, identique, du musée de l’Ermitage, à Saint-Pétersbourg, où elle esquisse un tendre sourire. Un sentiment de quiétude s’impose, suscité par les tons bruns de la salle à manger sur lesquels éclatent les blancs des vêtements et de la nappe. Quelques minutes auparavant, on entendait le tintamarre du tambour. À présent, dans le silence on attend. L’enfant saura-t-il réciter sa prière ? Sa mère (ou la servante) le grondera-t-elle ? Le bénédicité est un tableau en suspens, ce que confirme sur la nappe la fourchette en équilibre précaire. C’est aussi l’histoire de la place de chacun (et donc celle du peintre) dans la vie : l’enfant, à force de soumission, quittera-t-il la petite chaise pour s’asseoir sur la grande et souper à table ?

Dans le tableau du père, Orazio Gentileschi, Judith et sa servante, chargées de la tête d’Holopherne mise dans un panier tressé, posent, immobiles. Aucune trace de sang ne souille cette œuvre élégante. Dans ceux de sa fille Artemisia (il existe deux versions, à peu près identiques : seul le cadrage change), la décapitation est en cours, Holopherne résiste en vain, Judith bande ses muscles, sa servante appuie sur le corps du supplicié de toutes ses forces et le sang, déjà, éclabousse le lit. Le Caravage, dont s’inspire Artemisia (et dont s’inspirait aussi son père) en a peint, lui, une version théâtrale. À l’opposé, Artemisia se montre réaliste : on sent la fougue des femmes et surtout leur désir de tuer. Sous l’alibi du texte biblique (le Livre de Judith), ce tableau, peint vers 1615 et conservé au musée de Capodimonte, à Naples, est une vengeance. Se représentant en Judith, la jeune peintre a pris comme modèle, pour Holopherne, son ancien précepteur, le peintre Agostino Tassi, qui la viola. Peut-être est-ce l’origine de la passion qui anime ce tableau que le clair-obscur caravagesque intensifie encore.

Ce tableau, peint en 1777, appartient au sous-genre des scènes galantes (ou fêtes galantes) où s’illustrent Watteau, Boucher, Lancret et, bien sûr, Fragonard. De toutes ces peintures coquines, parfois grivoises, Le Verrou est la plus célèbre, la plus commentée, la plus équivoque aussi. On voit à l’évidence un homme en partie déshabillé fermer le verrou d’une chambre contre l’avis d’une femme, elle vêtue, qu’il voudrait embrasser et qui résiste – ou fait mine de résister. Le lit est défait. Le tissu rouge du baldaquin en cache la partie gauche où les rondeurs sous la couverture de satin blanc rosé pourraient laisser soupçonner une autre présence. Enfin, sur la table de chevet, une pomme intacte se trouve sur la trajectoire de la diagonale, à la fois lumineuse et structurante, qui de l’autre côté passe par le verrou. La chaise est renversée – il y a eu lutte. Au sol gît un petit bouquet de fleurs dans lequel certains historiens lisent la défloraison de la jeune femme. Le clair-obscur est admirable, le dessin tendu, nerveux et les couleurs sont chaudes – voire brûlantes pour la tenture rouge. Loin de toute galanterie, ce tableau est une scène de viol.

Le 2 mai 1808, les habitants de Madrid se révoltent contre l’occupant français. Ainsi débute la guerre d’indépendance espagnole, qui s’achèvera en 1813, et que Francisco Goya représente en 1814 dans un tableau El Dos de Mayo où l’on voit les Madrilènes armés de simples couteaux attaquer les hussards et les mamelouks de l’armée française. Le lendemain de l’insurrection, Joseph Bonaparte, frère de Napoléon et commandant des troupes d’occupation, organise une violente répression se traduisant par des exécutions sommaires, ce que montre ce second tableau de Goya, peint la même année 1814, El Tres de Mayo, aujourd’hui conservé au musée du Prado, à Madrid. Alors que demeurent, dans le premier tableau, un souffle d’héroïsme, un parfum d’épopée, un lyrisme propres à la peinture d’histoire (et de batailles), le second, malgré le clair-obscur dramatique, est un constat froid de la brutalité et de l’inhumanité de l’armée française ici alignée comme une machine à tuer. Aussi, le personnage central, dans une posture christique, seule tache blanche fortement éclairée en ce tableau ocré, a-t-il la charge de produire une puissante émotion.

On connaît la tragédie qui préside à ce tableau d’histoire conservé au Louvre : le naufrage de la Méduse, une frégate coloniale, au large des côtes du Sénégal en 1816. Deux ans plus tard, Géricault découvre le drame à travers le récit écrit par deux rescapés que le peintre va rencontrer. Alors débute une incroyable histoire : Géricault s’installe près de l’hôpital Beaujon, construit une maquette exacte du radeau, exécute des dizaines d’esquisses, se rend au Havre pour observer la mer (peut-être est-ce la cause de sa couleur vert glauque inimaginable au large du Sénégal), fréquente la morgue de Beaujon, se rase la tête et ne quitte pratiquement plus son atelier où travaille son assistant Jamar, modèle de quelques-uns des naufragés. Malheureusement, Géricault utilisa comme apprêt du bitume de Judée qui aveugle les détails et endommage irrémédiablement le tableau. Les couleurs sont ternies, mais la composition magistrale (trois pyramides) du tableau demeure, où se voit l’influence de la peinture de la Renaissance – en 1817 Géricault revenait d’Italie, le regard encore chaviré par Michel-Ange et Raphaël.

Delacroix peint Femmes d’Alger en 1833 dans son atelier parisien de la place de Furstemberg en utilisant des modèles féminins français, notamment son élève et maîtresse Eugénie Dalton. Il s’inspire de ses nombreuses esquisses et aquarelles réalisées lors de son voyage de trois mois au Maroc en 1832. Durant ce périple, il fait deux escales en Algérie – cinq jours à Oran et quatre à Alger – durant lesquelles il achète des bijoux, des vêtements, des objets de décoration qui serviront aux décors et aux costumes du tableau futur. L’appartement algérien a donc toutes les chances d’être un intérieur juif marocain (les seuls lieux privés où il eut le droit d’entrer). Et le tableau que Baudelaire voyait comme un poème qui « exhale je ne sais quel haut parfum de mauvais lieu qui nous guide assez vite vers les limbes insondés de la tristesse », montrant des femmes qui « cachent dans leurs yeux un secret douloureux », ce tableau donc, conservé au Louvre, est un collage, une œuvre recomposée par Delacroix, mais si puissante, aux couleurs si joyeuses, qu’à le voir « on est tout de suite ivre », disait Cézanne. En 1954-1955, au lendemain de la mort de Matisse qui avait repris à Delacroix ses odalisques, Picasso exécute quinze tableaux d’après les Femmes d’Alger.

Lorsqu’il peint ce tableau, en 1849, Courbet rêve de faire un coup d’éclat au Salon en montrant une composition en frise de 47 (peut-être plus) personnages dans l’esprit des portraits collectifs des gardes civiques hollandais du XVIIe siècle, telle La Ronde de nuit, de Rembrandt, peintre qu’il vénérait. Mais Courbet peint des gens ordinaires, sans héroïsme, sans flatterie, loin des codes académiques de l’époque. Aussi, s’il obtient bien une médaille de deuxième classe au Salon de 1850, le tableau, conservé au musée d’Orsay, suscite les quolibets et les critiques à cause de la laideur de ses personnages. Paraissant au premier regard sombre (les costumes noirs, le décor vert et ocre), le tableau est ponctué de teintes un peu plus claires dans sa partie gauche (blancs et rouges) et au centre (bleus pâles du tissu au sol et des bas). Quelle est sa signification ? Peut-être politique (l’enterrement du rêve républicain par la prise de pouvoir de Louis-Napoléon, futur Napoléon III) ; plus sûrement esthétique (ce serait l’enterrement de la peinture académique de son époque) ; quoique pour Courbet les deux se confondent – « le réalisme est par essence l’art démocratique », disait-il.

C’est un tableau merveilleux, conservé au musée d’Orsay. Le jeu de perspectives y est prodigieux. Le point de vue de Degas – et par conséquent le nôtre – se situe en légère hauteur, de façon à ce que notre regard se projette dans le fond, dans l’espace décrit par la jonction des lignes du plafond et du parquet, là où deux jeunes filles s’étreignent. L’étreinte se situe sur une horizontale menant au visage de la danseuse assise sur le piano et départageant le tableau en deux parties, le tiers supérieur (le plafond et le mur – un ciel dans un paysage) et les deux tiers inférieurs où se tiennent les danseuses disposées en frise. Le bâton du professeur partage, lui, le tableau selon des verticales (deux tiers à gauche, un tiers à droite). La composition est donc admirable, comme le sont les coloris, d’un raffinement extraordinaire, et la lumière, d’une délicatesse et d’une intelligence magnifiques. Degas fréquentait beaucoup l’Opéra de Paris. Plus de mille tableaux et dessins de danseuses en témoignent. Ils montrent le labeur, les douleurs, l’exigence, mais aussi la perversion de ces vieux en habit noir et des mères qui vendent leurs filles, et la corruption régnant dans les coulisses.

C’est, lui aussi, l’un des tableaux les plus commentés, immense (350 x 776), en noir et blanc, dans un style postcubiste, conservé au musée national Centre d’art Reina Sofía, à Madrid. Picasso le peint en 1937, quelques jours après le bombardement, commandé par les nationalistes espagnols et exécuté par les aviations allemande et italienne, de la ville basque, Guernica. Ce n’est pas pour autant un tableau d’histoire. Picasso ne représente pas Guernica, mais une scène théâtrale où, comme des personnages, jouent la violence, la souffrance et la mort. C’est pourquoi, au-delà de la tragédie de la guerre d’Espagne, le tableau est devenu une représentation des horreurs de la guerre, de toutes les guerres. L’aspect théâtral est précisé par le plafonnier allumé dans un espace où l’on ne pénètre que de côté ; par la lumière frontale et crue tombant sur les principaux acteurs de la pièce comme une poursuite ; et, bien sûr, par l’allusion à la corrida (cheval et taureau), qui est elle-même une mise en scène métaphorique de la violence, de la souffrance et de la mort.

Matisse peint ce tableau, conservé au Centre Pompidou, à Paris, deux ans avant sa mort, en 1952. Malade, ceint d’un corset de fer, il demeure dans un fauteuil roulant et commande à son assistante la pose des papiers qu’il colorie à la gouache et découpe. Le thème (selon Matisse : « Le roi triste, une danseuse charmeuse et un personnage grattant une espèce de guitare ») reprend celui de Salomé dansant devant Hérode, de son maître Gustave Moreau, et celui de David jouant de la harpe devant Saül, de Rembrandt. On y retrouve l’amour de Matisse pour la musique (le rythme admirable de la composition), le souvenir de son voyage à Tahiti (les motifs du décor) et sa passion pour la vie, la lumière, la couleur. Si l’on considère que le roi est Matisse lui-même, ce tableau, auquel le peintre trouvait une « expression profondément pathétique » est alors, comme le firent tant d’immenses artistes avant lui, une rêverie poétique sur la vieillesse et la mort, un autoportrait observant avec mélancolie la danseuse « charmeuse » qui, comme la reine du Madrigal triste, de Baudelaire, lui dit « Je suis ton égale, ô mon Roi ! ».

De Cimabue à Rothko, vingt tableaux touchés par la grâce
De Cimabue à Rothko, vingt tableaux touchés par la grâce
Il n’est pas de communauté sans art, sans qu’elle associe à un objet un haut degré de supériorité, d’élévation, une « éminence de la valeur » qui est pour l’anthropologue David Le Breton la définition du sentiment du sacré. C’est pourquoi les paléontologues imaginent les peintures rupestres comme des témoignages d’une religiosité primitive plutôt que comme les premières peintures d’histoire. Or l’art, même chrétien, ne fut pas toujours religieux. À l’origine, associée au paganisme, l’image se cantonnait à un rôle subalterne d’illustration. Ce n’est qu’au VIe siècle qu’elle acquiert son statut de médiatrice sacrée. L’Église l’encouragea, la contrôla ; et longtemps en Europe, jusqu’au Moyen Âge central, l’art religieux fut le seul. Son déclin s’amorce avec la Renaissance. Il disparaît avec le XIXe siècle. Mais le sacré a-t-il pour autant abandonné l’art ? Les lettrés chinois l’appellent le souffle-énergie. Sans lui la peinture est morte. Avec lui, elle donne un peu plus de vie à la vie et suscite ce que le psychanalyste Paul Diel appelait la religiosité : l’émerveillement face au mystère.
Olivier Cenna
C’est une fresque de l’église supérieure de la basilique d’Assise, très abîmée, dont les couleurs ont, pour certaines, viré et, pour d’autres, disparu. La dégradation a inversé les valeurs comme si se trouvait devant nous non la fresque originale mais sa radiographie. Il faut alors s’asseoir et regarder. C’est une expérience à la fois étrange et merveilleuse. Lentement les teintes disparues apparaissent, pâles d’abord, plus intenses à mesure que le regard s’habitue : des verts, des violets, des jaunes, des bleus, jusqu’à ce que la Crucifixion devienne multicolore et que son modelé se révèle. Alors la puissance de la composition s’impose – l’opposition entre la densité de la foule au pied de la Croix et la légèreté, la grâce des anges volant autour du corps souple du Christ. François est agenouillé au centre, entre Marie tendant les bras vers son fils et Jean tirant en un geste étrange le bas du pagne, mouvement qui décrit une diagonale commandant la disposition des anges. L’œuvre est magistrale.

Dans la chapelle des Scrovegni, à Padoue, Giotto réalisa autour de 1305 une série de 53 fresques portant sur trois thèmes (la vie de Joachim, la vie de Marie et la vie de Jésus) qu’accompagnent, en grisaille, les sept vices et les sept vertus. On considère cette chapelle comme son chef-d’œuvre. Parmi toutes les fresques, celle représentant le Baiser de Judas possède une dynamique extraordinaire commandée par le jeu des verticales et des obliques — les lances, les torches, les bâtons qui s’élèvent, se croisent comme le feront cent quarante ans plus tard les lances des cavaliers d’Uccello dans la Bataille de San Romano (le panneau du musée du Louvre). Cette effervescence occupe la moitié supérieure de la fresque. La moitié inférieure, sous la ligne sinueuse des têtes, évoque au contraire, par l’élégance des drapés et l’harmonie de leurs coloris, le calme et la douceur, comme si Giotto avait voulu signifier l’humanité nouvelle, moins soumise aux passions — en quelque sorte plus raisonnable.

En 1969, le cinéaste russe Andreï Tarkovski popularisa dans un film magnifique le nom d’Andreï Roublev. Jusqu’alors, seuls les spécialistes de l’icône orthodoxe connaissaient ce moine peintre dont la vie demeure en grande partie mystérieuse et sur lequel courent beaucoup de légendes. On sait qu’il se retira dans le monastère Andronikov à Moscou et qu’il eut comme professeur de peinture d’icônes Théophane le Grec. On lui connaît des fresques (des attributions) et avec davantage de certitude des icônes dont la plus célèbre est celle de La Trinité. Dans cette œuvre réalisée entre 1410 et 1427, actuellement conservée à la galerie Tretiakov, à Moscou, Roublev ne retient de l’épisode de l’apparition de l’Éternel à Abraham (Genèse, 18) que le repas des trois anges à l’ombre du chêne. Les couleurs, les plissés, la composition, tout est admirable dans cette icône qui, par définition, adopte la perspective inversée : contrairement à l’art occidental, la ligne de fuite va du tableau vers le spectateur.

D’après les historiens, Sano di Pietro, qui fut avec Sassetta l’un des plus grands peintres siennois du XVe siècle, était meilleur jeune qu’âgé. Après 1440, ça se gâte. Lui et surtout son atelier fabriquent à la chaîne. Auparavant, Sano se confond avec le Maître de l’Observance et peint quelques chefs-d’œuvre parmi lesquels figure cette majestueuse Nativité de la Vierge, datée de 1433 (environ) et conservée au musée d’art sacré d’Asciano, en Toscane – sans conteste plus élégante et raffinée que la Naissance de la Vierge (1448) du musée d’Art de l’Université du Michigan qui lui est attribuée. Il s’agit sans doute du panneau central d’un polyptyque disparu. Il relate la naissance de la Vierge, thème dont la plus ancienne représentation remonte au XIIe siècle (une mosaïque grecque). Il se singularise surtout par la somptuosité des coloris et la douceur de la lumière, qui donnent un sentiment de quiétude et de recueillement extraordinaire.

Le retable a été commandé vers 1430 pour le couvent San Domenico de Fiesole, près de Florence où Fra Angelico vivait. Les guerres napoléoniennes l’ont ramené au Louvre. Le thème du tableau illustre une légende, populaire dès le XIe siècle, selon laquelle Jésus couronne sa mère reine des cieux, légende s’inspirant d’une vision de l’Apocalypse, de Jean où la Vierge apparaît coiffée « d’une couronne de douze étoiles ». De ce thème, Fra Angelico fait un chef-d’œuvre. Composé selon une pyramide dessinée par les anges musiciens au sommet de laquelle Jésus couronne sa mère, subtilement équilibré grâce à l’alternance des bleus et des roses que rehausse et renforce un vert puissant, ce retable est une merveille à la fois par sa somptuosité et par la ferveur extraordinaire qui anime les visages des saints répartis de chaque côté du trône – au premier plan à gauche, agenouillé, figure même Louis IX. Tout ici – les mains, les gestes, les physionomies, le jeu des regards, les coloris –, tout est d’une délicatesse absolue.

La Descente de Croix, aujourd’hui conservée au Prado, à Madrid, fut commandée par la guilde des arbalétriers de Louvain vers 1430 pour leur chapelle Notre-Dame-Hors-Les-Murs, édifice détruit par les révolutionnaires en 1798. Ce tableau, achevé vers 1435, fut dès son origine considéré comme l’œuvre la plus belle du monde. Elle l’est toujours – du moins, l’une des plus belles. C’est un grand format montrant en haut une découpe crénelée inhabituelle pour un tableau mais caractéristique des retables sculptés – comme le sont aussi, dans les angles supérieurs, les ornementations gothiques, et, à l’arrière-plan, un mur doré composant une châsse dans laquelle s’encastre la scène –, et c’est pourquoi, de loin, lorsqu’on se trouve dans la salle 58a du musée et que l’on tourne la tête, il s’impose et donne un sentiment de volume extraordinaire, comme si l’on se trouvait face à un bas-relief polychrome. C’est un pur chef-d’œuvre.

Joris Van der Paele commanda le tableau à Van Eyck vers 1434 (le peintre le termine en 1436) afin de le donner à la cathédrale Saint-Donatien de Bruges dont il était le chanoine. L’œuvre est toujours dans cette ville belge, conservée au musée Groeninge. Le Louvre en fut un temps propriétaire lorsque l’armée française occupa les Pays-Bas (1794), et dut le rendre en 1816 après la chute de Napoléon. Cette conversation sacrée (ainsi se nomme ce thème), de composition complexe, réunit autour de la Vierge qui trône en majesté, le chanoine, bien sûr, et deux saints : Donatien, saint patron de la ville de Bruges, et Georges, saint patron du chanoine. Le décor, le chœur d’une église romane éclairé par la gauche, est d’une richesse extraordinaire que Van Eyck rend avec un réalisme minutieux : les tissus, les tapis, le carrelage, le manteau de Donatien, l’armure de Georges, etc. La même minutie s’attache au rendu du portrait du chanoine en dévotion. Ici, Van Eyck atteint le sublime.

Il est rare de voir le Christ ressuscité ainsi, le pied gauche posé sur la margelle du tombeau, le bras gauche reposant sur le genou, la main droite tenant l’étendard des Croisés symbole de la résurrection, le manteau tombé afin de laisser les plaies apparentes et le regard défiant presque le regardeur épaté. À sa droite c’est l’hiver et à sa gauche le printemps – la mort et la renaissance. Les quatre soldats dorment encore. L’un d’eux, le deuxième en partant de la gauche, serait un autoportrait – Piero della Francesca aimait à se représenter (dans le Polyptyque de la Miséricorde, la Légende de la Vraie Croix ou le Songe de Constantin). Parallèlement à sa carrière de peintre, Piero fut un géomètre et un mathématicien renommé, ce que l’on constate dans la composition, très maîtrisée, de cette œuvre, peinte vers 1465 et conservée au musée civique de Sansepolcro. Mais, au-delà des lignes de forces du triangle autour duquel s’organise la scène, au-delà même des couleurs et des drapés, et malgré l’épaule bizarre du soldat de droite, il y a surtout la vie palpitante et magnifique que l’on sent dans ces quatre corps assoupis

Une chose frappe immédiatement dans ce tableau émouvant conservé au musée de l’Accademia, à Venise : l’Enfant est beau ! Il n’est pas, comme les autres Enfants peints, ainsi que l’écrit Huysmans dans son Noël au Louvre, un nain, « un être hybride qui n’est plus un enfant, et qui n’est pas un Dieu ». Non, l’Enfant peint par Giovanni Bellini vers 1475-1478 est un bambin charmant, aux yeux très clairs, aux cheveux blonds, qui ressemble à l’autoportrait présumé de Bellini conservé au musée du Capitole, à Rome. Marie, très jeune et très belle, apparaît pensive, mélancolique, presque absente, loin de la tristesse habituelle des Mères mortifiées par la prophétie de Siméon concernant la mort future de Jésus – « à toi-même une épée te transpercera l’âme ». Ses mains, immenses, sont d’une finesse voluptueuse. Son Fils a le même regard absent, comme s’il pensait à autre chose. Il tient le pouce de sa Mère – « Vierge mère, fille de ton Fils », écrit Dante dans la Divine Comédie.

C’est encore l’un des plus beaux tableaux du monde dont la rénovation récente a fait ressortir toute la splendeur. Il est inachevé. Léonard de Vinci le commença vers 1503 – sans doute répondant à une commande passée vers 1500, mais on ignore qui en fut le commanditaire – et y travailla jusqu’à sa mort. Conséquence de l’inachèvement, quelques ombres manquent, notamment, à gauche du tableau, sur l’envers du manteau bleu de la Vierge, qui apparaît plus clair. Au début du XVIe siècle, le sujet de ce tableau conservé au Louvre, ce que l’on nomme la sainte Anne trinitaire (la Grand-Mère, la Mère, le Fils), soutenu par les autorités ecclésiastiques, se popularise. Il accompagne la conclusion d’une querelle théologique qui occupe l’Église depuis près de quatre siècles : Marie était-elle ou non préservée du péché originel ? – ce que l’on nomme le dogme de l’Immaculée Conception. Mais au-delà, ou en deçà, des interprétations religieuses et symboliques demeure une exceptionnelle harmonie – mieux : une infinie beauté.

C’est l’une des images les plus courantes du mystérieux sage chinois Lao Tseu, contemporain de Confucius (et de Bouddha !) au VIe siècle avant notre ère : il chemine sur son bœuf. La tradition – le mythe – attribue à Lao Tseu la paternité du Tao Te King ou Dao de Jing (le Livre de la voie et de la vertu), à l’origine du taoïsme, classé parmi les livres sacrés. Selon la légende, arrivant sur un bœuf noir à une frontière où on lui demandait un écrit, Lao Tseu composa d’un seul jet les cinq mille caractères du Tao Te King. Zhang Lu représente donc dans la main droite du saint les tablettes où est écrit le texte. Lettré, poète, Zhang Lu s’illustra par des paysages tourmentés (l’admirable Retour hâtif avant la pluie, du musée impérial de Pékin) et des portraits vigoureux. Dans cette encre légèrement colorée, conservée au musée national de Taipei, il allie l’épopée (l’énergie et le mouvement du bœuf) à la profondeur psychologique (le visage serein et empli de ferveur du vieillard).

Peinte vers 1564, l’œuvre représente un intérieur flamand plongé dans le clair-obscur. On y voit, sur la droite, la Vierge mourante dans son lit, entourée, selon La Légende dorée, de Jacques de Voragine, par une foule éplorée (apôtres, saints, saintes, martyrs et confesseurs), agglutinée dans le fond de la pièce. Près de Marie, Pierre dépose un cierge allumé dans ses mains ; à l’autre bout de la pièce, Jean l’Évangéliste dort (ou rêve) sur une chaise, près de la cheminée où brûle un feu ardent. Au premier plan, au centre du tableau, le peintre a disposé une table avec une bougie et une chaise. Sur le plateau de cette chaise est posé un livre — probablement le Nouveau Testament. Conservé à Upton House, à Banbury, en Angleterre, le tableau est peint en grisaille. C’est un pur jeu, à la fois complexe et subtil, de lumières dialoguant selon des courbes. Chaque courbe, si le regard la suit, raconte une histoire : soit religieuse, soit dramatique, soit d’amour, etc. C’est un petit tableau d’une intelligence prodigieuse.

À partir de 1564, le Tintoret se voit confier le décor (23 tableaux en tout) de la petite salle de l’Auberge, au premier étage de la Scuola Grande de San Rocco, à Venise – iI peint ensuite les 33 tableaux de la grande salle du chapitre et termine par les 8 tableaux du rez-de-chaussée. La Crucifixion est une œuvre immense (12 m x 5 m) installée au fond de la salle de l’Auberge. Comme souvent chez le Tintoret, une foule peuple l’œuvre où se mêlent les ouvriers chargés d’élever les croix, les officiers et soldats romains (ou plutôt turcs, alors les ennemis de Venise), la masse des curieux, au pied de la Croix la Vierge Marie, Jean et Marie-Madeleine accompagnés d’un homme barbu (le théologien Guillaume Postel ?) et de trois femmes (ce nombre demeure mystérieux), et d’une bonne douzaine de chevaux. Tout est admirablement construit, l’air circule, on entend le brouhaha, on sent le vent se lever sur le Golgotha, le Christ illumine la scène… C’est absolument fabuleux.

C’est à l’origine, en 1573, une commande pour l’église Santi Giovanni e Paolo, à Venise, une Cène venant remplacer celle du Titien détruite dans l’incendie du réfectoire. Mais le prieur de l’église s’offusque de la crudité de la représentation et demande des rectifications que Véronèse refuse de faire. À la suite du procès devant le tribunal du Saint-Office, Véronèse changea le titre et le tableau devint Le Repas chez Lévi, d’après un épisode de l’Évangile de Luc. Il faut dire que le peintre avait fait fort : un perroquet remplace la colombe du Saint-Esprit, les serviteurs sont noirs, les gardes sont déguisés en hallebardiers allemands, des Turcs (les ennemis !) participent au banquet, tout le monde ripaille et, au premier plan, un chien lorgne le postérieur d’un autre. On en condamnait pour moins que ça. Reste ce tableau, conservé au musée de l’Accademia de Venise, qui est vraiment un morceau de bravoure et de vie.

En 1606, le Caravage s’enfuit de Rome, où il vient de tuer un homme, et se réfugie à Naples, alors ville espagnole. L’année suivante, il peint deux chefs-d’œuvre : La Flagellation du Christ (musée Capodimonte) et le retable Les Sept Œuvres de miséricorde pour l’église de la congrégation du Pio Monte della Misericordia. Le tableau est peint en deux étapes : l’illustration des sept œuvres de la miséricorde (« Je visite, j’abreuve, je nourris, je rachète, je vêts, je panse, j’ensevelis », écrit saint Augustin), puis, à la demande des commanditaires, le Caravage ajoute la partie supérieure, les anges entourant Marie et son Enfant. Dans la petite église napolitaine où il demeure, la majesté du tableau se découvre d’une loge située à l’étage. La hauteur permet d’apprécier le magnifique mouvement des drapés, des ailes et d’avoir un regard englobant la totalité de la scène plongée dans un somptueux clair-obscur.

Lorsqu’il peint cette Descente de Croix en 1616 pour la chapelle du couvent des Capucins de Lille, Petrus Paulus Rubens est un artiste célèbre. Il est, depuis 1609, le peintre officiel de la cour de l’archiduc d’Autriche, Albert, qui a reçu les Pays-Bas en dot lors de son mariage avec l’infante Isabelle d’Espagne. Il vit à Anvers où il a fait construire un palais dans lequel il a installé son atelier. Une première Déposition, un triptyque, peinte en 1614 a sans doute servi de modèle à celle-ci. Les compositions sont proches, centrées sur le corps et le linceul du Christ, un cercle grossier qui se déploie en une ellipse s’enroulant autour des diagonales définies par le linceul. Le clair-obscur caravagesque, hérité de son voyage en Italie entre 1600 et 1608, se trouve adouci, moins ouvertement dramatique que dans le triptyque. Sans doute parce que la lumière artificielle, signe du baroque, y est moins violente, moins contrastée. Ce tableau conservé au palais des Beaux-Arts de Lille est un oxymore : un voluptueux déchaînement.

Il fallut qu’un historien de l’art allemand, Hermann Voss, se penche sur son cas en 1915 pour que Georges de la Tour sorte de l’anonymat dans lequel le temps et l’oubli l’avaient plongé. On attribuait ses tableaux non signés à d’autres, plus prestigieux que lui. Conséquences de l’anonymat et d’un incendie qui ravagea Lunéville, la ville où il vivait, sa vie demeure en partie mystérieuse. On sait qu’il fut peintre officiel du roi Henri II. Puis on l’oublia. À partir de l’exposition Les Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle, au musée de l’Orangerie, en 1934, tout change. La Tour devient un héros, un peintre singulier et original. On admire son clair-obscur, en partie influencé par Le Caravage (a-t-il fait le voyage en Italie ?), mais qui en diffère par la source lumineuse visible, le plus souvent une bougie, qui plonge la scène – ici dans ce tableau du Louvre peint vers 1645, Marie et Joseph accompagnés de bergers autour du nouveau-né – dans une atmosphère à la fois calme, feutrée, silencieuse et emprunte d’une religiosité remarquable.

À partir de 1630, Zurbarán peint beaucoup de tableaux représentant saint François d’Assise, et son atelier encore plus (une quarantaine de versions en tout). Le saint est debout, agenouillé, en extase, priant, ou, comme dans ce tableau conservé à la National Gallery de Londres, méditant. Le peintre espagnol s’est, comme de La Tour, inspiré du Caravage et de ses lumières. Il a cependant une manière très particulière, pour ainsi dire intimiste, d’éclairer, témoignant d’une religiosité et d’une profondeur magnifiques. Les ordres monastiques raffolaient du dépouillement et de la sobriété dont faisait preuve sa peinture, si proche de leur propre ascétisme. Ainsi Zurbarán vêt François de la tunique abîmée, recousue, effilochée, d’un ordre mendiant (les Frères mineurs récollets). La cellule est plongée dans l’obscurité que perce une lumière latérale qui n’éclaire que le côté droit de la tunique, une parcelle du visage et surtout les mains retenant le crâne. C’est un tableau – une vanité – qui réussit la prouesse d’être à la fois fantastique, réaliste et abstrait.

Peinte pour le maître-autel de Port-Royal des Champs, La Grande Cène de 1652, conservée au Louvre, succède à deux versions plus petites. Ici, Champaigne se recentre sur la trahison annoncée par le Christ et l’émoi que suscite l’annonce. La scène est épurée – sérieuse. Les disciples ne sont pas alignés face au regardeur (Léonard de Vinci) ; ni réunis autour de la table (Tintoret) ; ni même festoyant (Véronèse). À la manière des personnages d’un sépulcre, ils laissent libres les places face au Christ, invitant le regardeur à ce dernier souper où il n’y a à manger que le pain et le vin que Jésus partage avec ses apôtres. Ainsi, par cet ascétisme – et par l’invitation qu’il nous lance –, Champaigne précise qu’il ne s’agit pas seulement du dernier repas du Christ, mais de la fraction du pain, l’élément central de la doctrine chrétienne : le sacrement de l’eucharistie. Et il le précise avec une élégance (ah les bleus !), une grâce uniques.

En 1959, le magazine américain Life montra sur une double page, à gauche la photographie d’un coucher de soleil et à droite un tableau abstrait de Mark Rothko dans les mêmes tonalités. La peinture était donc associée à un paysage – celui-ci, conservé à la fondation Beyeler, à Bâle, serait alors une nuit orageuse. Cela répondait à l’incompréhension devant des tableaux méditatifs, sans dessin, sans trait, composés d’aplats géométriques de couleurs aux contours imprécis, flous. Le critique d’art américain Clement Greenberg appela ce genre, regroupant une vingtaine de peintres (Barnett Newman, Ad Reinhardt, Clyfford Still, etc.), le colorfield painting. Mais ce terme, « champ de couleur », ne laisse pas entrevoir la dimension mystique de l’œuvre de Rothko, grand lecteur de mythologie. L’homme se nourrissait de tragédies antiques ; le peintre cherchait le sublime dans l’effacement de soi ; une religiosité (l’émerveillement face au mystère) parcourt ses toiles sacrées, forcément sacrées.

De Van der Weyden à Giacometti, vingt portraits qui ont changé le visage de la peinture
De Van der Weyden à Giacometti, vingt portraits qui ont changé le visage de la peinture
L’art du portrait remonte à la plus haute Antiquité. L’Égypte des pharaons et l’Empire chinois le pratiquaient il y a plus de trois mille ans – les Grecs un peu plus tard, vers le Ve siècle avant notre ère. Il disparaît de l’art occidental à l’époque médiévale, ne subsistant dans les tableaux religieux qu’à travers le personnage du donateur, pas toujours reconnaissable. Les premiers portraits autonomes, sur bois, apparaissent au milieu du XIVe siècle en Bourgogne et en France – ils sont peints de profil comme le portrait du roi Jean II le Bon (s’il s’agit bien de lui), conservé au Louvre. Puis, jusqu’au développement de la photographie à la fin du XIXe siècle, le portrait devient un genre majeur, classé au XVIIe siècle juste derrière la peinture d’histoire. L’autoportrait, lui, si l’on en croit Pline l’Ancien et Ovide, existe depuis le IVe siècle avant notre ère en Grèce où Apelle, peut-être pour se différencier de son rival Pamphile, peignait sur les vases son portrait en guise de signature, principe que reprennent certains enlumineurs au Moyen Âge. L’art du portrait dans l’Histoire est intimement lié à la conception que l’époque a de l’individu et à la place de ce dernier dans la société. Ainsi, d’abord interdit par le christianisme au Moyen Âge, il est ensuite réservé aux riches et aux nobles, avant que la photographie le popularise – le selfie (aussi appelé l’égoportrait) précisant bien la réalité de l’époque contemporaine.
Olivier Cenna
Entre la fin du règne de l’empereur romain Tibère, mort en 37, et la fin du IVe siècle, l’art funéraire de l’Égypte, conquise un siècle plus tôt par Rome, évolua, enrichi par l’apport de l’art grec. Les masques mortuaires qui couvraient le visage des momies devinrent des représentations fidèles (et sans doute idéalisées) des défunts. L’art du portrait fut introduit en Égypte par les Romains – Pompéi témoigne de l’usage du portrait familial dans les demeures cossues. On peut donc imaginer qu’à son usage purement funéraire les Égyptiens ajoutèrent celui de l’image souvenir. Parmi ces portraits figuratifs – réalistes, même –, celui de cette jeune femme, conservé au Metropolitan, de New York, se distingue par la beauté du modèle, par l’expression de son regard et par la vie intense qui anime la peinture.

La plupart des historiens pensent qu’il s’agit d’un autoportrait car l’homme représenté est beau, et qu’un génie de la peinture se doit d’être beau. Mais nul n’en est certain. Car de Jan Van Eyck, sans aucun doute l’un des plus grands peintres de l’histoire de la peinture, on ne sait pas grand-chose. On connaît quand même la date d’exécution de ce portrait : 1433. Van Eyck devait alors avoir une quarantaine d’années. Son réalisme, qui n’a d’égal en son temps que celui des tableaux d’un autre peintre flamand, Rogier Van der Weyden, avait pour les contemporains du peintre quelque chose de stupéfiant. Van Eyck, au début du XVe siècle, invente le glacis, qui consiste, sur un panneau en chêne couvert d’un enduit de plâtre et de colle, d’apposer les pigments colorés, mêlés à un médium à l’huile, par couches transparentes successives. Ainsi naissent la lumière, l’harmonie et la splendeur.

Frère de Charles le Téméraire, Antoine est l’un des nombreux bâtards du duc Philippe III de Bourgogne, élevé en 1452 à l’âge de 31 ans au statut envié de « Grand Bâtard de Bourgogne ». Le portrait qu’en fait en 1460 le peintre flamand Rogier Van der Weyden, alors réputé dans l’Europe entière, montre un jeune homme charmant, un peu mélancolique peut-être, le cou ceint de l’ordre de la Toison d’or et la main droite tenant une flèche dont la signification demeure mystérieuse. Mais cette peinture d’une grande élégance, aujourd’hui au musée Oldmasters Museum de Bruxelles, est sans doute trompeuse puisque le peintre allemand Hans Memling exécute une dizaine d’années plus tard un portrait d’Antoine où le fils du duc apparaît laid, les traits amollis, la bouche moins charnue et, surtout, le menton moins volontaire. Rogier, dit-on, aimait à flatter le client ; ici, il en anoblit un peu plus la peinture.

Selon la tradition, peu après son élection, le doge de Venise se fait portraiturer à ses frais par le peintre le plus réputé de la ville. Vers la fin de l’année 1501, Giovanni Bellini peint donc le portrait de Leonardo Loredan, soixante-quinzième doge de Venise, vêtu de son habit officiel et coiffé, recouvrant un premier bonnet de lin blanc, du corno ducale (ce que les Vénitiens appelaient la zoïa – le joyau), le chapeau de cérémonie de l’élu. Bellini signe sur le parapet de bois, dans le « petit papier » (en italien le cartellino). Il est alors probablement septuagénaire et au sommet de son art : douceur et somptuosité de la lumière, harmonie entre la figure et le fond, transparence et subtilité des coloris. Ce portrait est conservé à la National Gallery de Londres, musée où l’on peut aussi admirer un autre chef-d’œuvre, le portrait de L’Homme au turban rouge, de Van Eyck.

Quand on croise ce portrait anonyme dans le musée Oldmasters Museum de Bruxelles, nul ne peut rester indifférent devant l’intensité et la fixité du regard de l’enfant. Il fascine. Puis le regard, le nôtre, voyage dans le tableau, note la beauté du tissu de la robe et de la coiffe, la subtilité de leur couleur blanche légèrement jaunâtre, la rudesse de la pâte qui là se fait épaisse, contrastant avec la peau diaphane du visage, de la grâce du ruban bleu pâle ourlant le col de la robe et liserant la coiffe. Le fond brun, très sombre, s’opposant à la clarté des vêtements et de la peau de la fillette, concourt à la dramatisation de la scène. Au début du 16e siècle, l’artiste anonyme connaissait son affaire, mais qu’a-t-il voulu représenter en montrant une fillette tenant un oiseau mort dans sa main ? L’a-t-elle trouvé ainsi ? L’a-t-elle étouffé dans ses mains ? Et son regard, est-il surpris, triste ou coupable ?

Quelque inculte assombrit un jour le fond du tableau – c’était à l’origine un dégradé de bleu-gris. Est-ce le même qui retoucha la coiffe et la main droite de La Dame à l’hermine ? L’animal, que Léonard ajouta après avoir commencé son portrait, a perdu son pelage blanc de l’hiver ; mais il n’a pas encore le ton brun de l’été. Il n’a plus son éclat d’origine. La peinture s’est ternie, mais le tableau, peint par Vinci en 1498, actuellement exposé au Musée national de Cracovie (il n’est la propriété de l’État polonais que depuis quatre ans), demeure malgré ces injures en bon état. Moins célèbre que La Joconde, le portrait de la jeune femme se singularise par la position de trois quarts du visage et par le regard qui, sans être pensif, regarde délibérément sur le côté. La composition en est admirable et le sfumato, effaçant subtilement les contours, renforce encore la grâce de l’ensemble.

Baldassarre Castiglione (1478-1529), comte de Novilara, établi à la cour d’Urbino, alors l’une des plus raffinées d’Italie, réputé pour ses missions diplomatiques (en Angleterre, auprès des papes, auprès de Charles Quint en Espagne), est en son temps surtout connu pour avoir écrit en 1528 Le Livre des courtisans, ouvrage décrivant ce que doit être le parfait homme de cour. Il rencontre Raphaël (1483-1520) à Rome, lors de son ambassade auprès du pape Léon X. Les deux deviennent amis. Le portrait, aujourd’hui conservé au musée du Louvre, sans doute offert par le peintre, date de cette première ambassade, entre 1514 et 1515. Castiglione ne s’en sépara jamais, l’emmenant dans tous ses voyages, inconsolable de la mort précoce de son ami. C’est une merveille copiée par Rubens un siècle plus tard (vers 1625) et par Matisse à la toute fin du 19e siècle.

Alessandro Farnèse, né en 1468, cardinal à 23 ans, fut élu pape le 13 octobre 1534 sous le nom de Paul III. En 1543, passant par Bologne et Ferrare, il se rendit à Busseto pour y rencontrer Charles Quint – à l’instigation de ce dernier, le pape convoquera en 1545 le concile de Trente, moteur de la Contre-Réforme. C’est là que Titien fit son portrait. Il y en aura deux autres en 1446, l’un où Paul III est coiffé de la barrette et l’autre où il est en compagnie de ses deux neveux, où il apparaît vieilli et voûté. Ici, dans le tableau conservé au musée de Capodimonte, à Naples, vêtu d’un camail de velours bordeaux découvrant le somptueux drapé blanc de la robe, Paul III conserve l’acuité de son regard. À l’époque, Titien en fit une copie exacte pour le neveu du pape, le cardinal Sforza. Un temps perdue, elle a été retrouvée il y a cinquante ans, accrochée dans la sacristie de la cathédrale de Tolède…

De son vrai nom Jacopo Carucci, Pontormo est un artiste immense. Il passa toute sa vie à Florence où il étudia dans l’atelier d’Andrea del Sarto et où il fut, au milieu du 16e siècle, après le départ de Michel-Ange pour Rome, le peintre le plus réputé. François Ier, sur les conseils de l’Arétin, lui préféra Rosso Fiorentino, lui aussi élève de del Sarto, qu’il fit venir en France pour réaliser les grandes décorations du château de Fontainebleau. Les princes aussi se trompent. Sur cet autoportrait, Pontormo ressemble à Van Gogh. De loin, dans la petite salle du musée Amedeo Lia de La Spezia où le tableau est conservé, avec la silhouette noire (un bleu de Prusse) se détachant sur le fond violine et ce visage tendrement éclairé où, sur la joue gauche, le rebord du bonnet dépose une ombre colorée lie-de-vin, de loin, donc, l’œuvre montre une modernité étonnante. C’est un tableau exceptionnel.

Marguerite de France, c’est la fameuse reine Margot, première épouse d’Henri IV, dont Alexandre Dumas fera l’héroïne de l’un de ses romans. On date la réalisation de ce dessin colorié vers 1559, ce qui est étonnant car l’enfant n’aurait ici que six ans. Marguerite est alors une princesse, fille du roi Henri II et de Catherine de Médicis. Le portrait dessiné, dont François Clouet fait un genre en soi – il était jusqu’alors préparatoire au tableau –, est utilisé pour conclure les mariages, comme cadeau diplomatique, comme souvenir affectif ou même comme jeu de cour (le nom est caché et l’on doit deviner qui est représenté). Celui de Margot, conservé au musée Condé, de Chantilly, d’une grande délicatesse, montre aussi, à partir de 1550, le souci de François Clouet de représenter avec un réalisme admirable le moindre détail, que ce soient les perles du collier ou les broderies de la robe.

L’ecclésiastique, ici âgé de 29 ans, était un grand ami du Greco. Professeur à l’université de Salamanque, poète, il était aussi le prédicateur officiel du roi Philippe IV. Autour de lui se retrouvent les principaux poètes et lettrés espagnols. Il était, dit-on, extrêmement intelligent, cultivé et affable. Ce sont ces qualités qu’exprime le Greco dans cette peinture, ainsi qu’une certaine légèreté, quelque chose de tendre et de généreux. En 1609, lorsqu’il le peint, le Greco, âgé de 68 ans, est malade. Les nombreux procès que lui intentent ses commanditaires (l’atelier du peintre, en particulier son fils, diffusait des produits dérivés (broderies) et des copies des tableaux commandés) le ruinent peu à peu – il meurt démuni, en 1614. Pourtant, il fait preuve, lorsqu’il portraiture son jeune ami, d’une fougue et d’une délicatesse mêlées, extraordinaires.

Pourquoi pas le portrait du fameux Pape Innocent X qu’aimait tant Bacon ? Parce qu’il y a dans ce portrait de Pacheco, moins célèbre mais tout aussi magnifique, l’expression de l’amitié et de l’admiration. L’homme fut un peintre médiocre, l’un des maîtres de Velázquez, et surtout un fin lettré, d’une intelligence remarquable, plus célèbre en Espagne par ses écrits que par ses tableaux. Et surtout parce que la peinture de Velázquez est absolument admirable, nimbée d’un clair-obscur d’une grande douceur rehaussé par le blanc magique de la collerette. Conservé au musée du Prado, à Madrid, le Portrait de Francisco Pacheco montre la subtilité de Velázquez : la psychologie du modèle ne provient pas de je ne sais quelle mimique, elle naît de la texture de la peau, de la lumière sur l’aile du nez, de la sinuosité de la barbiche. Elle naît de la peinture.

Rembrandt est, de tous les peintres du 17e siècle, celui qui s’est le plus représenté : plus de quatre-vingts fois en dessin, gravure ou peinture, que la peinture soit une « tronie » (genre mêlant portrait et scène de genre) ou un autoportrait. Son premier autoportrait, à l’âge de 22 ans, date de 1628. Le dernier est peint l’année de sa mort, en 1669. Il succède de trois ou quatre années peut-être à cet Autoportrait aux deux cercles aujourd’hui conservé à Kenwood House, près de Londres. Ce dernier est un tableau hâtivement peint (la main tenant la palette est esquissée), empâté, rude mais enluminé d’un splendide clair-obscur qui offre au vieil homme un écrin poétique admirable. Les deux cercles se réfèrent à l’anecdote selon laquelle Giotto dessina devant le pape Benoît IX un cercle parfait – anecdote précisant la place, l’égal de Giotto, que se réservait Rembrandt dans l’histoire de la peinture.

Nul ne sait qui est le modèle de ce tableau célèbre, surnommé la Joconde du Nord, dont on ignore aussi l’origine. Les rares textes et catalogues citant les oeuvres de Vermeer parlent de « têtes » et de « troncs », mots alors employés pour les portraits. Le tableau n’apparaît officiellement qu’à la fin du 19e siècle lors d’une vente aux enchères, avant d’être légué au Mauritshuis de La Haye en 1903. Il est abimé, victime de repeints, mais la vie qui émane du visage, la délicatesse des lèvres rosée, la peau translucide, la somptuosité chromatique de la coiffe, le regard à la fois étonné, un peu mélancolique et candide, tout cela demeure intact. Selon les historiens qui se réfèrent à un texte de Saint François de Sales sur Isaac et Rebecca, la perle serait le symbole de la chasteté. Le tableau aurait alors pu être commandé à Vermeer pour un mariage.

Elle fut la peintre préférée de la reine Marie-Antoinette dont elle fit de nombreux portraits, la plupart gentiment embellis. Royaliste, elle s’enfuit, à la Révolution française, en Italie puis rejoint la cour impériale autrichienne à Vienne avant de revenir définitivement en France en 1809. Elle considérait ce Portrait du peintre Hubert Robert, peint en 1788 et conservé au Louvre, comme son chef-d’œuvre. Et c’est bien un tableau magnifique, sublimement éclairé, extrêmement vivant. On rapproche l’œuvre de Vigée Le Brun de celui de Quentin de La Tour, mais on sent dans ce tableau, par la position du corps, le rendu de la lumière et des chairs, l’influence de Fragonard (son Autoportrait de 1769). Pour une fois il ne s’agit pas d’un portrait mondain, où la peintre excellait, mais d’une œuvre intime et amicale. Elle est alors adulée, dépense sans compter, offre des dîners somptueux, mais sait demeurer, face à son confrère, d’une sincérité admirable.
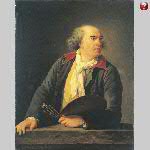
Née Marie-Clotilde-Inès de Foucauld, madame Moitessier épousa à 21 ans un veuf deux fois plus âgé qu’elle ayant fait fortune dans l’importation de cigares cubains. Voilà pour le sujet – et la mélancolie du visage. Quant à la peinture de ce tableau, peint en 1851 et conservé à la National Gallery of Art de Washington, c’est l’extraordinaire qualité du noir de la robe, profond et brillant, contrastant avec le noir mat des dentelles. Il crée une masse compacte et lumineuse au centre de l’œuvre, accentuée par le mur recouvert d’un velours rouge aubergine dont les motifs renforcent la platitude. Le luxe décoratif s’oppose à l’absence de détails anatomiques, aux rondeurs, à la peau trop lisse, à la rigidité de la coiffure. Les trois couleurs dominantes – un rouge, un noir et un gris – renvoient aux trois couleurs qu’utilisera un siècle plus tard l’Américain Mark Rothko, trois bandes horizontales créant, comme ici, un espace vertigineux.

C’est un petit tableau, aujourd’hui au musée d’Orsay, qu’offrit en 1876 Manet à son ami Mallarmé afin de le remercier de l’article que le poète venait de publier dans une revue anglaise, The Art Monthly Review, le 30 septembre 1876. Ce texte intitulé Les Impressionnistes et Edouard Manet plaçait ce dernier comme le précurseur du mouvement. Les deux hommes s’étaient connus en 1873 et entretenaient depuis une relation étroite, parlant chaque jour de peinture et de littérature, bien sûr, mais aussi de mode féminine. La réalisation du tableau fut rapide, comme en témoigne la vivacité des coups de brosse. Un sentiment intense de vie s’en dégage, comme si Manet était parvenu à le peindre durant le temps que prit Mallarmé à fumer son cigare. Un « curieux tableautin » disait avec pudeur le poète. Où « rayonne l’autorité de deux grands esprits », ajouta Georges Bataille.

Bien malin qui pourrait dire à quoi ressemblait Hortense Fiquet, compagne puis épouse de Cézanne. Le peintre fit pourtant vingt-neuf portraits de cette femme qu’il rencontra en 1869 (elle avait 19 ans), qu’il épousa en 1886 et dont il eut un enfant. La « biquette » des débuts devint vite « la boule » – et le fils « le boulet » – mais cela n’empêcha pas Cézanne de lui infliger de longues heures de poses pour la rendre finalement complètement inexpressive. Il la peint comme il peint une pomme, immobile, et, comme le remarqua l’écrivain anglais D.H. Lawrence, « En même temps il met en mouvement le monde immobile. Les murs tressautent et glissent, les chaises se penchent ou se cabrent légèrement, les tissus se recroquevillent comme du papier qui brûle ». L’ambition de Cézanne n’est pas d’exprimer la vie d’un visage, c’est de revenir à l’expérience primordiale de la création du Monde – être, en quelque sorte, modestement Dieu.

La découverte en Avignon en 1973 des dernières œuvres de Picasso, deux mois après sa mort, donna lieu à un florilège de bêtises (il était devenu gâteux), la plus puissante revenant à l’opportuniste commissaire d’exposition Harald Szeemann qui, aveuglé par Duchamp, déclara que « Picasso ne signifie plus rien ». Le Vieil Homme assis, conservé au musée Picasso à Paris, date de 1971. C’est une leçon de peinture que l’arrogance des « expérimentateurs » de l’époque ne pouvait supporter. Or lui, Picasso, non seulement supporte mais expérimente ici l’héritage cézannien : c’est le monde autour de la figure qui bascule par la grâce des accords colorés. On remarquera le discret hommage à son rival et ami de toujours, Henri Matisse, dans l’épaule gauche reprenant le motif de la Blouse roumaine. Et surtout la vérification de l’adage cézannien : « Quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude. »

Un jour, un jeune étudiant en philosophie japonais venu étudier à Paris voulut rencontrer Giacometti dont il admirait l’œuvre. Il devait rentrer au Japon, mais le sculpteur suisse, hypnotisé par son visage, le retint plusieurs mois. Ainsi, Isaku Yanaihara devint le modèle exclusif de Giacometti, s’attirant même la jalousie de Genêt qui venait de se faire portraiturer. Entre les deux hommes se noua une amitié étrange. Isaku devint, poussé par Alberto, l’amant d’Annette, sa femme. Quant à Alberto, il ne cessa de pleurer, de hurler devant ce visage asiatique qu’il ne pouvait saisir sur la toile ou en sculpture. Ce portrait, peint en 1960 et conservé à la fondation Goulandris, à Athènes, prouve le contraire. Dans les tons habituels de gris et de beiges (les portraits de Giacometti sont en fait des dessins rehaussés), Alberto restitue l’expression où, sous le flegme et le calme apparents, pointe une touche d’inquiétude – celle, sans doute, de se trouver là, dans l’atelier, livré volontaire à son bourreau.













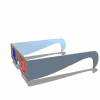





























































































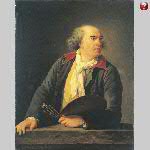







 En mai on fait ce qu'on peut
En mai on fait ce qu'on peut